13 septembre 2019
Transcription : Frédérique Khazoom et Nyassa Munyonge
Édition : Maude Trottier
Louis Pelletier : Pour ouvrir cette table ronde qui porte sur les mauvais genres, la question de la cinéphilie me semblait importante. Il y a trois ans, Jean-Pierre Sirois-Trahan m’a dit que c’était simple, au fond, le mauvais genre : ça pouvait se résumer, en gros, à tout ce qui n’a pas fait l’objet d’une critique dans les Cahiers du cinéma ou, à une certaine époque, dans 24 images. Ce soir, le point de départ est le suivant : nous sommes à la Cinémathèque québécoise et nous vous avons invités en tant que représentants d’une nouvelle génération. Les gens qui ont bâti la Cinémathèque québécoise ont à l’époque mené un combat pour légitimer le cinéma en tant qu’art. Des Robert Daudelin, des Pierre Jutras se sont par conséquent interrogés selon les critères de leur époque sur ce qui est approprié de montrer et de conserver. Depuis les années 1960–1970, les choses ont évolué, tant en ce qui a trait aux archives de la Cinémathèque qu’à ce que l’on veut y montrer. C’est aussi un peu le moment de faire le point dans cet endroit, soit une institution qui possède une riche histoire de ce que veut dire être cinéphile. Or, qu’est-ce que veut dire être cinéphile en 2019 ? Est-ce que c’est synonyme de s’en tenir simplement à un certain type de cinéma, ou est-ce qu’au contraire, ça peut vouloir dire de se montrer un peu plus ouverts et tendres vers les « mauvais genres » ? Nous vous avons invités, Julie et moi, parce qu’en plus de votre expertise ou connaissance des mauvais genres, vous êtes également des cinéphiles éclairés, vous connaissez bien votre Bergman, votre Fellini, etc. Bref, j’aimerais qu’on explore ce soir la tension entre le cinéma légitimé ou d’auteur et les autres corpus qu’on redécouvre et qu’on essaie de revaloriser. Aussi, il y a un nombre important de pratiques qui se situent en dehors du cinéma pour les salles et du cinéma d’auteur ou en-dehors des pratiques qu’on pourrait qualifier d’un peu plus respectables. Autrement dit, on ne parle pas seulement des films en eux-mêmes, mais des pratiques entourant la réception, de la consommation des films, et donc des communautés cinéphiliques qui se nouent autour des films. Je pense en effet que l’on doit discuter, ce soir, aussi bien de films que de communautés et de pratiques.

Un changement de paradigme ?
Francis Ouellette : Si tu me permets, je te lancerais une anecdote. Dans le cadre de mon travail, je vis une relation bicéphale au cinéma parce que je suis d’une part cinéphile – et j’adore le cinéma de genre – et d’autre part, un distributeur qui ne travaille pas sur le cinéma de genre, mais qui se spécialise plutôt dans les films dits d’Art et essai. Je suis donc toujours déchiré entre les deux postures. Je ne pourrais pas aisément distribuer du cinéma qu’on pourrait qualifier de genre au Québec pour des raisons platement économiques. Mais cette année, c’était la première fois que, dans le contexte de mon travail, j’allais au Festival de Cannes. Pour aller acheter les films, les rapporter, mais aussi pour voir et superviser ce qui se passait au niveau de la vente de nos films sur le territoire français via les vendeurs internationaux. J’ai eu un assez gros choc. Cette mouture du festival était saturée des thèmes du genre, à travers des films qui célébraient l’hybridité entre le cinéma d’auteur et le cinéma de genre. Même dans les films en compétition, ça sentait le genre, et je ne parle pas juste de Jarmusch qui parle de zombies ou de Bertrand Bonello qui parle aussi de zombies, ou du film Bacurau (Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles, 2019), hommage débridé à l’intérieur du film Art et essai au cinéma de John Carpenter. Et puis, en tant que distributeur au marché, on se promène dans les allées de vente où j’ai pu constater qu’il n’y avait que des films de genre et très peu de films d’auteur ou de documentaires. On retrouvait dans ces allées plutôt des films de kung-fu, des films policiers, des films d’horreur en quantité. Le vent est en train de tourner. Le fait que tu puisses le sentir à Cannes, ça veut dire qu’il y a vraiment un changement de paradigme en train de se produire. Même la Palme d’or de cette année a été attribuée à un réalisateur associé au genre (Parasite, Bong Joon-ho, 2019).
David Fortin : Et on sent que tous les cinéastes importants qui ont été considérés comme cinéastes d’auteur, que ce soit Jarmusch ou le cinéaste qui a fait Neighbouring Sounds (2012) et Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho, aiment jouer avec le genre. Qu’ils se revendiquent d’un certain cinéma de genre qu’ils ont admiré à une certaine époque et que tranquillement, ils le laissent transparaître dans leur cinéma. Mais tu parlais de Cannes et de l’importance du genre dans le festival, on le sent aussi depuis quelques années dans les festivals, ici. Que ce soit le Festival du nouveau cinéma (FNC) qui, avec la section « Temps 0 », a ouvert la porte au genre ou avec Fantasia, festival des films de genre par excellence, qui devient de plus en plus populaire, d’année en année.
Francis Ouellette : Un quart de la programmation de Fantasia vient maintenant direct de Cannes. Il se passe quelque chose, le changement est palpable.
Mathieu Li-Goyette : L’autre quart vient de la Berlinale et du marché européen, aussi saturés par le genre. D’ailleurs, ça fait deux années que je vais à la Berlinale et je remarque autant là-bas que dans les circuits festivaliers européens que les grands films porteurs qui proposent des réflexions de fond sur le cinéma le font souvent par le biais du genre. Par exemple, La flor (Mariano Llinás, 2018), qui était un événement Rotterdam, TIFF avant 2018, qu’on a fait venir à Montréal récemment au Cinéma Moderne, film de 14 heures, entreprend de réfléchir l’histoire du cinéma à travers le genre, la place du genre dans le cinéma, la manière dont le genre, avec ses contraintes de tournage, ses contraintes scénaristiques, narratives, est venu former un paysage cinématographique à l’aide de référents qu’on peut facilement lire, déceler. J’ai l’impression que ce qui ressort de tout ça, c’est que plus on avance dans l’histoire du cinéma et dans l’évolution de notre perception des choses, plus le genre ou les genres cinématographiques deviennent peut-être ce vers quoi on est en train de reconfigurer une forme d’ontologie du cinéma. Se dire qu’est-ce qui est typiquement cinématographique ? Bien c’est peut-être le western. Avec Tarantino, par exemple, on arrive souvent un peu à ce type de réflexion esthétique-là où en tous les cas, les genres vont servir vraiment de point d’amarre pour que s’affirme un « vrai cinéma ». C’est un cinéma qui, outre le « vrai » cinéma au sens hégémonique, revendique facilement l’espèce d’héritage classique associé au genre.
Francis Ouellette : Pendant longtemps, on s’attendait dans le milieu festivalier international à un film de qualité, à une certaine esthétique et une certaine suite des thèmes. Je pense à un cinéaste comme Albert Serra, par exemple. Albert Serra sort un film et c’est un événement. Même chose pour Pedro Costa. Or, ces dernières années, il y a de plus en plus d’impatience envers ce type de cinéma-là, aussi bien au niveau de sa durée que de son rythme ou de son contenu. Les errances contemplatives sur pellicule tendent à emmerder beaucoup de gens en ce moment. Il va y avoir toute une génération de cinéastes qui, bientôt, n’intéresseront plus beaucoup de personnes. Ça va être difficile par exemple pour un cinéaste comme Philippe Grandrieux d’aller toucher une nouvelle génération, on dirait qu’il a épuisé son capital d’attention, si vous voulez. Je ne mentionnerai pas le film parce que je trouve ça agressif, mais récemment Les Cahiers du cinéma ont évoqué ce cinéma-là en parlant d’« érection festivalière molle » ou de « contemplatif chic ».
Julie Ravary-Pilon : Par rapport à cet effet-là, je trouve qu’on a souvent « tapé » sur le cinéma québécois, mais c’est effectivement une tendance peut-être plus internationale. Quelles sont les tensions que tu remarques ici ?
Francis Ouellette : On observe un écart démesuré, étant donné que l’on parle d’un cinéma d’État subventionné à 98 %. Nous avons un cinéma qui est un peu de grille : cochons ceci, cochons cela pour avoir notre financement et espérons, dans le meilleur des cas, que nos films voyagent et fassent les festivals. C’est bon pour la santé économique et culturelle de tout le monde au Québec de faire ça. Mais la formule commence elle aussi à s’user. Je dirais même que si l’on peut considérer que la division entre la gauche et la droite idéologiques est de plus en plus grande et agressive, on la perçoit jusque dans l’opinion sur le cinéma. Il y a tout d’un coup une voix populaire qui s’élève et ose dire : « C’est ce cinéma-là que paient mes taxes. Je ne le reconnais pas. » Les résultats du box-office canadien sont récemment sortis en ordre chronologique. Le film Menteur (Émile Gaudreault, 2019), produit par Cinémaginaire1 avec ses six millions et des poussières, a fait plus d’argent que tous les quinze ou vingt films canadiens subséquents. Le Canada au complet dans les quinze films, n’a pas fait autant d’argent… Le fossé est énorme.
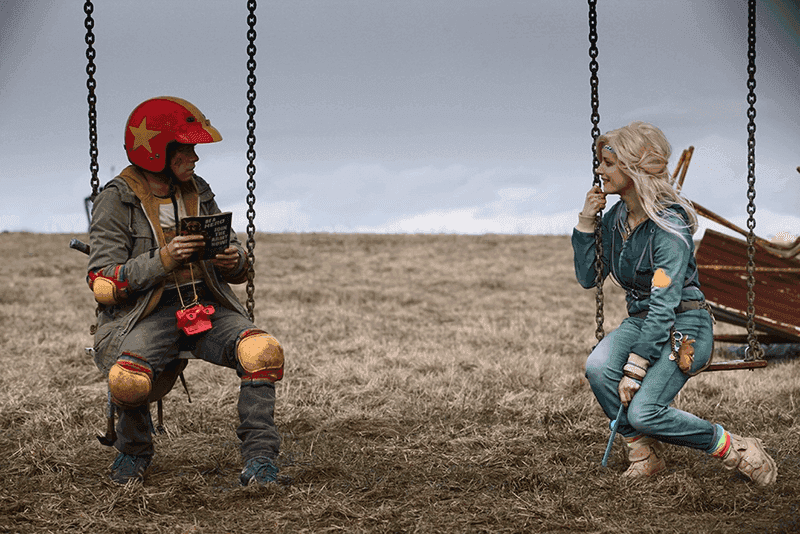
Réseaux et décloisonnement des genres
Louis Pelletier : Pour continuer sur les chiffres, on peut souligner l’importance des réseaux. Quels sont les réseaux du cinéma de genre ? Dans quel contexte le public va-t-il rencontrer le cinéma de genre en 2019 ? On a parlé de festivals. On peut dire que Fantasia Montréal, c’est fondamental, en raison des communautés et des groupes que le festival rassemble autour du cinéma de genre, du cinéma culte, etc. Mais sinon, de quoi parle-t-on quand on parle des revenus d’un film ? De sorties en salles ? De streaming ? De dvd ? De ventes aux télévisions ? De tout ça ? Au début de ton intervention, Francis, tu disais que le cinéma de genre, c’était casse-gueule pour un distributeur. Pour moi, ça n’a pas valeur d’évidence.
Francis Ouellette : Je prendrais un exemple. Le film qui a peut-être changé un peu la donne, c’est Les affamés (Robin Aubert, 2017). C’est un cas intéressant parce qu’il fonctionne justement selon ce type de cinéma hybride dont on parlait, à la fois film de genre et film d’auteur. C’est presque un champ de réconciliation des deux types de cinéphilie. Et s’il faut que le cinéma de genre fonctionne au Québec, il va probablement devoir apprendre cette façon de faire d’une certaine manière, intégrer de façon assez organique, entretenir le commensalisme. Que l’on pense à un film comme Turbo Kid (François Simard, Anouk Whissel & Yoann-Karl Whissel, 2015), par exemple, qui est un pur film de genre. Yoann-Carl Roussel, un des réalisateurs du collectif, disait que le film avait été fait en anglais parce qu’il n’avait aucune chance d’exister en français au Québec. Il aurait été au mieux cantonné à quelques représentations aux festivals.
Louis Pelletier : Mais est-ce que ça veut dire qu’il y a peut-être des réseaux horizontaux et verticaux ? Turbo Kid, c’est peut-être un bon exemple au Québec : dans notre communauté, on en a parlé, mais dans les médias, pas forcément. Ce n’est pas vrai que ma tante à Rivière-du-Loup a entendu parler de Turbo Kid ! Mais je ne serais pas surpris si l’on me disait que ce film-là a beaucoup plus circulé à l’international qu’une comédie québécoise ou un film d’auteur.
Simon Chénier : Le film est disponible sur Netflix partout ailleurs, mais pas ici. Ici, le moyen de le voir, c’était soit en salle ou en location sur Apple.
David Fortin : Il était sur iTunes, aussi. J’ai l’impression que le « grand public » l’a vu parce qu’il y avait un ruban autour du film, un hype et que de cette façon, le film a beaucoup circulé. Menteur – ou peu importe la comédie québécoise de l’heure qui fait vraiment beaucoup d’argent ici – s’exporte super mal, parce que les référents humoristiques y sont très québécois. Ce type de films n’est probablement pas vraiment distribué ailleurs qu’ici.
Simon Chénier : On peut comparer la réception de Turbo Kid au Québec à celle reçue par le film dans le reste du monde avec les prix Aurore d’Infoman2. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, cet évènement fait parler des films. Laurence Leboeuf, actrice de Turbo Kid3, y a reçu une nomination pour le rôle de la moins bonne comédienne, alors que ce personnage-là est aimé par plein de monde, ailleurs. Il y a du monde qui ont des tattoos de ce personnage-là, mais ici, c’est comme « ah, c’est un peu weird », alors on n’aime pas ça.
Francis Ouellette : C’est comme si notre culture de masse n’avait pas les référents, qu’elle est incapable de comprendre les mécanismes du genre. Et on le voit par exemple à Radio-Canada. La vieille gang se demande « qu’est-ce qu’on va faire ? », alors que Les mystérieux étonnants4 s’intéressent aux films de genre depuis dix ans déjà. Ça me fait penser à la fameuse scène de Ready Player One (Steven Spielberg, 2018), où il y a des compagnies qui ne connaissent absolument pas les référents de la culture geek et qui engagent des geeks de service pour dispenser leur savoir à la masse.
Louis Pelletier : Et puis, il y a eu l’autre événement cette année quand Alexandre Fontaine Rousseau s’est retrouvé devant Franco Nuovo5. Le clivage générationnel entre l’ancienne cinéphilie et la plus jeune est assez évident, violent, même.
Julie Ravary-Pilon : J’enseigne le papier d’Alexandre Fontaine-Rousseau et l’affaire Fontaine-Rousseau-Nuovo à l’émission radiophonique de Christiane Charette dans le cours de Cinéma québécois. Les étudiantes et les étudiants adorent parce que, justement, cette entrevue-là illustre parfaitement le clivage générationnel.
Simon Chénier : Mais aussi, on parlait de l’intérêt pour le genre dans les festivals. Dans ma vie personnelle, quand j’écoutais des films de séries B il y a dix ans, les gens me disaient : « Ah ouais, tu écoutes juste ça ? » Non, je n’écoutais pas juste ça. Maintenant, les gens sont beaucoup plus intéressés. Ils posent des questions sur ces films-là parce que clairement il y a un intérêt.
David Fortin : J’ai l’impression que justement, on peut aller s’émouvoir du film Entre la mer et l’eau douce (Michel Brault, 1967) et, quelques jours après, regarder Miami Connection (Richard Park & Y.K. Kim, 1988) ou Fast Life (Thomas Ngijol, 2014) ou peu importe. Il y a de moins en moins de distinctions entre les diverses cinéphilies parce qu’elles se mélangent et se développent à travers ce à quoi on a été exposé au fil du temps. Cette nouvelle cinéphilie se sent à travers cette génération qui endosse aussi bien les rôles de professeur que de cinéaste et de programmateur de festivals. J’ai l’impression que cette ligne entre cinéma d’auteur et de genre est maintenant brouillée. Tout s’influence. Ça se voit dans la programmation du FNC qui ouvre une porte au cinéma de genre ou dans celle de Fantasia qui de son côté se penche, avec « Camera Lucida », sur un cinéma qui est peut-être plus d’auteur, tout en continuant de se référer au genre.
Francis Ouellette : Ceci n’est pas une plug parce que je ne fais plus partie de ce podcast-là dont j’ai été un membre fondateur, mais David fait encore partie du 7ème antiquaire6. L’une des idées fondamentales de ce podcast, c’était justement d’opérer ce décloisonnement-là, c’est-à-dire saisir l’occasion de parler d’un film de série B ou d’un film culte avec toute la diligence avec laquelle on parlait d’un grand chef‑d’œuvre ; ou encore, parler de chefs d’œuvre cinématographiques à partir des critères d’analyse appropriés au film de genre. En tant que cinéphile, je regarde Carnival of Souls (Herk Harvey, 1962) comme un drame bergmanien. Et L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961) pour moi, c’est un film d’horreur, un film hanté, un film de zombies, de fantômes, de revenants. Quand on essayait de faire cet exercice-là en 2006, on avait vraiment l’impression d’être dans un monde où ce décloisonnement n’existait à peu près nulle part. J’avais vraiment l’impression qu’on était les freaks de service et on adorait ça, mais plus les années avançaient et moins on était des freaks.
David Fortin : C’est drôle, car cette approche critique s’est développée en bris de la popularité ou d’une meilleure place publique. On le voyait, la plupart des films dont on traitait au 7ème antiquaire dans les cinq dernières années ont tous eu des rééditions Blu-ray. Ils sont sortis de nulle part, ils sont passés du 35 mm au Blu-ray tout d’un coup. Il y a une demande pour ces films-là qui étaient oubliés ou qui étaient mal aimés. Maintenant, ils ont droit à des restaurations 4K qui doivent coûter une fortune.

Marché et distributeurs
Francis Ouellette : Quel serait le marché du dvd et du Blu-ray en ce moment si ce n’était pas de ça ?
Louis Pelletier : Oui, on parle d’Arrow7 et c’est le cas que j’ai en tête, mais au Québec, qui occupe ce créneau ?
Eva Létourneau : On a un film québécois qui va sortir chez Severin8, The Peanut Butter Solution (Michael Rubbo, 1985), avec une restauration. C’est un cas où l’international nous aide à restaurer nos chefs‑d’œuvre redécouverts. Il y a un intérêt international pour des films qu’on redécouvre. Bon, Élephant9 en fait beaucoup, mais c’est certain qu’on ne va pas chercher un public large avec ces films. Donc quand tu as de l’aide à l’international pour sortir une restauration 2K d’un film comme celui-là, ça ajoute quelque chose. Les cinéphiles aiment acheter, mais on n’a pas assez du marché québécois pour sortir un Blu-ray 4K d’un film de genre québécois des années 1970.
Louis Pelletier : Est-ce que c’est une question de droits ? Francis, tu es en distribution, est-ce que de sortir des films patrimoniaux en Blu-ray, c’est un cauchemar pour la gestion des droits ?
Francis Ouellette : Sortir un film en dvd, chez nous, en ce moment, ce serait un cauchemar, pour des questions de droit ou plus généralement financières. C’est comme la cinématographie italienne des années 1960–1970 qui a couvert tous les genres. Les cinémathèques de partout à travers le monde qui veulent jouer tel ou tel western spaghetti, tel ou tel giallo font « merde, on ne sait pas du tout qui a les droits ». On n’arrive pas à retracer les droits. On a plein de films comme ça au Québec.
Eva Létourneau : Je pense que notre seule porte sera de passer par des compagnies qui peuvent distribuer beaucoup plus largement pour que ça vaille la peine de faire des sorties des films qu’on voudrait pour nous-mêmes, chez nous. Mais avant qu’il y ait Arrow, qu’il y ait Vinegar Syndrome10, qui est très fort maintenant aussi, qu’il y ait Severin… Ça fait quand même plusieurs bons joueurs qui peuvent sortir des films et ça permet de distribuer et de faire connaître le cinéma québécois. C’est juste drôle que ça ne passe pas par chez nous. En même temps, le marché n’est pas assez gros ici.
David Fortin : Ils se sont bâti une réputation qui fait que maintenant, ils peuvent sortir ce truc-là. Pour l’international, The Peanut Butter Solution, ça ne sonnera pas de cloches, mais ils vont être intrigués : « Ah, ça vient de Severin ».
Mathieu Li-Goyette : Justement, il y a un cas intéressant pour ça. C’est le cas d’Evokative Films11 qui a été créé par Stéphanie Trépanier. En voyant le succès populaire de Fantasia, elle a eu l’idée de partir une boîte de distribution à Montréal et s’est dit : « pourquoi ne pas partir une boîte mais qui soit focalisée sur le genre et qui puisse répondre aux attentes des cinéphiles de genre, c’est-à-dire produire de belles éditions dvd, bien foutues, avec des commentaires audio, des suppléments ? » Le genre de traitement de luxe qu’à peu près aucun autre distributeur de films au Québec, à ma connaissance, faisait à ce point-là. C’était vraiment unique. Stéphanie Trépanier achetait les films qui fonctionnaient le mieux à Fantasia. Son protocole était assez simple. Je crois que ça a duré près de trois ans, cette aventure. La chute fut assez dure, car elle a persisté en se disant que ça allait finir par décoller, qu’à un moment donné, le principe de collection – le type qu’on peut retrouver chez Criterion, Amos ou Severin – finirait par prendre le dessus et que les gens pourraient se dire « OK, c’est un Evokative ». Mais ça n’a pas pris. J’en avais parlé avec elle à l’époque, et la grosse brique qui lui était tombée sur la tête, c’était de réaliser que les gens qui sortent de chez eux pour aller à Fantasia au mois de juillet disparaissent le reste de l’année. Que cet effet de masse – on est en gang, on aime le genre, on va en salle, on achète des billets, on achète des posters et des dvd à la table d’Arrow – ne durait pas… Rendus en septembre, ces gens-là ont complètement disparu de la carte.
Julie Ravary-Pilon : Est-ce que ces cinéphiles de genre préfèrent l’expérience en salle ?
Mathieu Li-Goyette : C’est compliqué Fantasia, parce que ce n’est pas juste une question d’expérience de salle. C’est une expérience événementielle. C’est tout ça qui entre en ligne de compte. Ce sont aussi des gens qui collectionnent les catalogues de Fantasia et qui les échangent parce que : « ah, moi j’ai un double de 1998 et toi tu en as un de 1996 et je le veux. » Tu n’as pas de fans du FNC comme ça. Ce sont des gens qui empilent leurs expériences festivalières fantasiennes, parce que c’est vraiment le festival de la nostalgie et du souvenir. Tu vas l’entendre entre cinéphiles : « ah, te rappelles-tu en telle année quand on avait vu un tel film et que telle personne est sortie en ambulance ? » C’est un festival qui se construit beaucoup, comme les communautés de genre, à travers l’anecdote, puis à travers un rapport très intime à l’objet qui est regardé.
Francis Ouellette : C’est un fait intéressant que la projection festivalière dans la province de Québec fait toujours profondément mal à la sortie en salles. On est maintenant à cet extrême-là où les distributeurs doivent négocier d’arrache-pied pour avoir les plus petites salles possibles et de mauvaises journées de premières pour s’assurer que la sortie en salles ne va pas être totalement morte et escamotée. Si tu as eu 1 500 personnes à Montréal pour aller voir un film japonais de 3 heures et demie, qu’est-ce qui se passe ? Quels autres fans veulent ça à Montréal et au Québec ? Parce que la cinéphilie montréalaise et la cinéphilie de la province, c’est complètement deux mondes. Montréal est un épicentre d’intérêt culturel singulier, le bilinguisme aidant, aussi.
Louis Pelletier : Mais il n’y a pas autre chose ? Je n’ai jamais vécu à Québec, mais j’ai beaucoup d’amis qui sont ou qui étaient à Québec et il me semble que ce que je ressentais, c’est que Québec, c’est une ville où, en surface, il ne se passe pas beaucoup de choses, seulement, lorsque tu es dans le réseau, il y a toujours quelqu’un qui organise quelque chose. Il y avait un club d’otaku. Si tu étais fan d’anime, il y avait une salle à l’Université Laval où, à tel jour, une personne allait faire une projection.
David Fortin : J’ai l’impression que ça s’est développé plus tardivement parce que du temps que j’étais à Québec, les films de répertoires, cultes ou bis ne se trouvaient pas facilement.
Francis Ouellette : Vous demanderez éventuellement à David Fortin de vous raconter ses histoires, ses épopées de quand il montait à Montréal pour finir à la Boîte Noire et qu’il ramenait à Québec 20 vhs en shakant parce qu’il ne les trouvait pas là-bas, les films.
David Fortin : En même temps, ça fait maintenant vingt ans que je suis à Montréal et c’est sûr que depuis les vingt dernières années, j’ai l’impression que ça s’est beaucoup développé. Il y avait quand même quelque chose qui était là, auquel je n’étais peut-être pas aussi attentif.
Eva Létourneau : Il y avait quelques places. Moi, adolescente, je dépensais 50 $ par semaine au Vidéodrome, un club vidéo de Québec. J’y allais toutes les semaines et y revenais semaine après semaine.
David Fortin : Tu avais également Antitube12 qui faisait des trucs. Pour les cinéphiles, il y avait un moyen de s’en sortir. Pour le cinéma de genre en tant que tel, tu avais la télé ou tu avais les films qui sortaient en salles. Le cinéma de genre est quand même distribué en général, mais si tu cherchais du pointu, il fallait à cette époque-là que tu ailles au club vidéo Cartier dans le centre-ville.
Mathieu Li-Goyette : Le fait que ça ait été de niche, je pense que c’est un peu le même cas partout. Je ne veux pas oser parler d’exception québécoise, mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans notre marché. Il y a eu des marchés de niche comme ça un peu partout dans les années 1990 en Occident, mais là, en ce moment, on vit à une époque où, justement, le genre se démocratise. Le genre se popularise, se mainstreamise très rapidement partout sauf ici, comme on en parlait tantôt avec l’exemple des chroniqueurs de Radio-Canada qui ne savent pas en parler. Quand ils abordent le genre, comme tu parlais tantôt de l’intervention de Franco Nuovo, ça sonne comme un discours totalement aberrant pour des gens qui s’entendent sur ce cinéma-là.
Eva Létourneau : Est-ce que ce sont les institutions qui ne suivent pas le marché ou le public ?
Mathieu Li-Goyette : J’ai le goût de dire qu’une raison souterraine à tout ça, c’est le français. C’est l’indisponibilité des sous-titres français et le fait que le cinéma de genre, si tu ne parles pas du tout anglais, ça ne t’est quand même pas accessible. C’est peut-être quelque chose qui est peu dit, mais je pense qu’à Radio-Canada, la raison pour laquelle ça a pris autant de temps avant de s’intéresser, par exemple, aux superhéros ou à la culture geek, c’est parce que c’est une culture anglophone. Parce qu’au Québec, on a un sentiment d’infériorité où on se dit que n’importe quoi qui vient des États-Unis, c’est tout de suite une marque de l’impérialisme américain qui cherche à nous envahir. Alors qu’à notre époque, ce n’est pas ce qu’on ressent. Quand on regarde un film de genre, un film de série B ou un film qui pastiche un genre, peu importe, ou qu’on voit justement une référence à un cinéma hollywoodien classique dans un film d’auteur coréen ou argentin, on n’est pas en train de se dire : « Ah, saleté d’Américains ! Ils ont vraiment pris possession de la culture mondiale. » On a vraiment dépassé ces discours-là.
Francis Ouellette : Tu te rends compte que, finalement, il y a un complexe d’infériorité dans la culture québécoise et en même temps, une profonde fierté d’avoir sa particularité. Elle s’exprime partout, cette espèce de bipolarité culturelle. Tu la vois partout et pour cette raison, le genre ne s’est jamais mieux exprimé chez nous que du côté canadien avec Cinépix13. Je suis persuadé que tôt ou tard, il y a un collectionneur qui fera : « Hey man, le Maple Syrup Exploitation, le Canuxploitation ». Il y a aussi le fait que c’étaient des films qui ne rechignaient pas à avoir des comédiens anglophones un peu populaires ; des Christopher Plummer à gauche, name it. D’ailleurs, je trouve qu’une des sections les plus intéressantes de Fantasia, c’est « Genres du pays14 ». J’ai fait des découvertes fulgurantes les dix dernières années à travers cette section. Il y a un buddy cop surnaturel comme Bon Cop, Bad Cop (Érik Canuel, 2006) avant l’heure qui s’appelle La lunule ou The Pyx (Harvey Hart, 1973), avec Christopher Plummer et Donald Pilon qui chassent un Jean-Louis Roux sataniste. Et tu t’exclames : « Oh, je n’ai jamais entendu parler de ça ! »
Julie Ravary-Pilon : Fantasia avait programmé Pouvoir intime (Yves Simoneau, 1986) en 2014, un thriller avec une gender-fluid Marie Tifo qui est l’atout physique de la bande de criminels. Son personnage effectue toutes les tâches qui demandent une maîtrise ou une force physique. Très rafraichissant pour l’époque ! Je n’aurais jamais vu ce film si ce n’était du travail de programmation de Fantasia. C’est presque absent de tous les ouvrages sur l’histoire du cinéma québécois.
Eva Létourneau : Le problème, c’est que si les films n’ont pas marché, il reste peu d’éléments pour faire des restaurations. Car s’ils n’ont pas voyagé, et même si ce n’étaient pas de grosses productions, très souvent, on n’a pas tous les éléments du film.
David Fortin : Tu parlais de Pouvoir intime. C’est un film qui n’a même pas eu droit à son dvd. Il y avait bien eu une vhs, mais c’est tout. Alors comme tu dis, des sections comme « Genres du pays » ça devient justement un moyen important de montrer les films de genre. Du cinéma de genre, on en a fait au Québec et pas juste depuis les vingt dernières années.

Acquisition et conservation
Louis Pelletier : D’un point de vue d’historien, ce qui est difficile, c’est qu’on va surtout parler des films que l’on connaît. Et ceux qu’on connaît, c’est ceux dont on parle. Dans le cinéma québécois, pour beaucoup de critiques ou d’historiens des années 1960, 1970 et 1980, un bon film, c’était un film qui cadrait bien avec une certaine vision nationaliste du Québec émergent, qui se battait contre l’envahisseur étranger. Je ne sais pas ce que Yves Lever, par exemple, a pu écrire au sujet d’un film comme Mustang (Yves Gélinas & Marcel Lefebvre, 1975), un film de genre de cowboys, mais ça m’étonnerait qu’il ait porté ce film aux nues. Comme les gens de cette génération-là en ont peu parlé – et s’ils l’ont fait, c’est probablement avec un certain mépris –, un tel film est appelé à disparaître. Il devient donc presque impossible d’avoir accès à ce qui pourrait toujours exister comme copie et d’en discuter. À la Cinémathèque, ça ressemble à quoi vos politiques, tant au point de vue des acquisitions que de la programmation ?
Eva Létourneau : C’est quand même le fun de retourner dans les archives, je dois dire. Je me promène dans les allées et je rencontre des films que j’aimerais voir et voir en salle aussi. La programmation ne me concerne pas beaucoup, je ne travaille pas dans ce département-là, je suis aux collections et c’est certain qu’on ne fait pas des acquisitions selon les genres. Tout ce qui est québécois et canadien est dans notre priorité d’acquisition, peu importe le genre.
Louis Pelletier : On peut évoquer Cinépix, par exemple, qui est vraiment fondamental en histoire de cinéma de genre au Québec. Est-ce qu’à la Cinémathèque québécoise, vous avez un fonds Cinépix ? Est-ce que ces films-là sont bien conservés ? Est-ce qu’il y a des négatifs originaux ou des éléments de tirage qui existent ?
Eva Létourneau : Je ne connais pas particulièrement l’histoire de Cinépix à la Cinémathèque, mais dès qu’on a des possibilités d’acquérir des fonds issus du cinéma québécois ou canadien, c’est toujours une priorité. Et souvent, ces films-là sont des priorités de conservation par le fait qu’ils ont peu voyagé, qu’ils ont eu une petite vie par rapport à certains autres films. Beaucoup moins d’éléments existent autour de ces films et ces éléments deviennent donc très précieux. Car si on a une seule copie d’un film dans la collection, ce n’est pas assez pour la conservation. On considère que l’œuvre n’est pas protégée et alors, ne peut pas être projetée. C’est ça aussi le problème. Les projections de ces films-là, si on n’a pas assez d’éléments en ce qui les concerne, on ne peut pas en bonne conscience les laisser se promener et être projetés. On essaie d’être actifs pour permettre la conservation à long terme ou la restauration éventuelle de ces films-là et c’est toujours notre but à long terme.
David Fortin : Juste pour compléter, il y a bien des archives Cinépix. Je te confirmerai si c’est réellement un fonds ou une somme d’éléments, mais dans les archives, on a bel et bien les cartables que la distribution Cinépix construisait autour de la réception des films.
Eva Létourneau : Parfois, il y a également des problèmes de droits pour les acquisitions, par exemple lorsque les gens ne sont plus là ou disponibles pour signer les autorisations. On a beaucoup de films en dépôt, ce qui constitue un problème. Dans le cas où les gens ne sont plus disponibles, ne serait-ce que pour faire des restaurations, il faut essayer de retracer les gens pour savoir si on peut sortir le matériel, si on peut l’envoyer au laboratoire.
David Fortin : Je serais curieux de savoir pour les acquisitions. Tu disais que tout ce qui est québécois ou canadien, par défaut, vous allez le prendre. Mais pour le reste, pour l’international, est-ce qu’il y a des personnes qui vont décider de ce qui doit être conservé ? Est-ce que le genre va jouer dans leurs décisions ? Par exemple, avec un film d’horreur des années 1980.
Eva Létourneau : Ce n’est pas vraiment le genre qui joue. C’est certain que le cinéma expérimental et le cinéma d’animation sont deux de nos priorités d’acquisition. Parce que le cinéma expérimental est un cinéma très marginal d’une certaine façon, très peu protégé. Les artistes, parfois, jouent leurs propres inversibles15 et c’est certain que si des gens nous offrent ces films-là ou si on a la possibilité de les acquérir, on les veut aussi pour cette raison. On veut essayer de protéger le cinéma qui est très précaire, ce qui vient aussi avec des difficultés énormes dans la documentation des œuvres. Il n’y a pas de documentation des œuvres, d’informations sur comment les œuvres doivent être projetées, par exemple. Souvent, on n’a même pas de copie de référence lorsqu’on veut faire une restauration. Tous les films qui ont eu une petite vie à la base amènent pas mal de problèmes, c’est toujours difficile de les faire revivre.
Louis Pelletier : On parle parfois de la schizophrénie québécoise au sens où notre culture dans le domaine du cinéma, entre autres, s’est beaucoup constituée par l’appropriation des pratiques des films étrangers. Ça remonte jusqu’aux bonimenteurs, si on revient aux recherches de Germain Lacasse, et au doublage au Québec ? Je pense que c’est enjeu vraiment important. Pendant longtemps, on n’avait pas les moyens d’avoir une industrie qui allait sortir une centaine de films de fiction par année. Donc, on doublait les films étrangers pour les rendre accessibles et puis souvent, dans ces cas-là, il y avait une forme d’appropriation, un doublage qui n’est pas transparent, comme avec Slap Shot (George Roy Hill, 1977), Les Lavigueur (Dick Maas, 1986) ou Les Pierrafeu (ABC, 1960–1966) à la télévision. Mais c’est là, peut-être, où la contribution des collectionneurs est importante et intéressante parce qu’on peut imaginer qu’une cinémathèque souhaite conserver la meilleure version d’un film, qui est la version de l’auteur. Est-ce que le doublage, pour une cinémathèque, c’est une production intéressante ?
Eva Létourneau : Ça dépend vraiment des œuvres. Il y a des cas où personnellement, j’étais très en faveur de conserver la version française. Un film comme Seed of Chucky (Don Mancini, 2004), par exemple, je trouve plus intéressant d’en conserver la version doublée en français, que de garder des copies doublées d’un Gus Van Sant. Il y a quand même des cas où ce n’est pas nécessairement notre politique générale de faire ça, mais on le considère quand même selon les genres. Et puis, je dirais qu’on est quand même plusieurs à s’intéresser au cinéma de genre dans des institutions comme la Cinémathèque. Je ne considère pas que ça soit mal vu d’aimer ou de travailler sur ce sujet. Ce n’est pas nécessairement ce que je fais dans mes tâches principales, mais par exemple, j’aime beaucoup travailler sur les bandes-annonces. Au fil du temps, on a fait des projections d’équipe de bandes-annonces de films érotiques et autres. Laisse-toi faire, la neige est bonne (Henri Sala, 1976), la bande-annonce est complètement ridicule, c’est fantastique.
David Fortin : Et justement, cet intérêt-là, je ne sais pas s’il était présent avant que tu n’arrives, du moins, j’ai l’impression que je n’en entendais pas autant parler.
Eva Létourneau : C’est sûr qu’en me promenant dans la collection, je tombe sur des curiosités. On découvre même des films que l’on ignorait être des œuvres canadiennes. Je pense à la bande-annonce d’un film comme The Yin and the Yang of Mr. Go (Le Troisième œil, en français, Burgess Meredith, 1970). C’est un film avec Jeff Bridges dans un de ses premiers rôles et on pense que c’est possiblement une co-production canadienne. C’est en sortant la bande-annonce qu’on s’en est rendu compte.
David Fortin : J’allais juste glisser un mot pour compléter par rapport aux politiques d’acquisition. Il y a des doublages faits au Québec en joual, par exemple. Est-ce que, au-delà de tes intérêts dans la politique ou des décisions des directeurs de projection, on peut dire que l’importance de ce doublage en joual est reconnue et considérée ?
Eva Létourneau : C’est arrivé récemment qu’on garde des films en doublage français, mais ce sont des titres qui ont été sélectionnés. Moi, je pense à faire des listes des films doublés à conserver. Je dirais quand même que l’on considère qu’il y a un public pour des types de films comme ça.
David Fortin : C’est juste au niveau du public ? Ce n’est pas à un niveau historique, que c’est important, historiquement, de conserver ça ?
Eva Létourneau : Je ne sais pas comment les autres jugent ça, mais on peut considérer Fantasia, qui vient aussi s’approvisionner en copies chez nous. La présence de La Cinémathèque interdite16 par exemple peut nous convaincre de garder des copies dans notre collection de diffusion – qui n’est pas notre collection de conservation de films québécois – en sachant qu’il y a un public que ça peut toucher. Mais comme on ne peut pas tout garder, on ne garde pas forcément les doublages de tous les films.
Julie Ravary-Pilon : Ça fait combien de temps que tu fais ce travail à la Cinémathèque ?
Eva Létourneau : Je travaille à la Cinémathèque depuis à peu près trois ans, mais sur différents postes.
Julie Ravary-Pilon : Est-ce que vous voyez une progression ou bien ça a toujours été là, cet intérêt du public dont tu parlais ?
Eva Létourneau : Je ne suis pas très au courant des données entourant le nombre d’entrées en salle. Les cycles classiques attirent énormément de monde. La Cinémathèque interdite attire un autre type de gens qui ne viennent pas à la Cinémathèque d’habitude.
David Fortin : J’ai l’impression, en tous les cas, qu’il y a quand même eu, de façon semi-régulière, des projections de « films de genre » à la Cinémathèque ou de films qui penchent vers les genres. Chaque fois, ça peut être surprenant de voir le nombre de personnes que ces projections attirent, habituées ou nouvelles. Avec Panorama-cinéma, on avait présenté A Touch of Zen (King Hu, 1971) qui est un film qui s’inscrit dans le genre du wuxia, donc du film de sabre et d’épée chinois, et c’était une salle comble.
Louis Pelletier : Je pense que c’est quand même assez nouveau que la Cinémathèque présente du cinéma de genre.
Francis Ouellette : C’est venu avant cette vague-là. Je me souviens, il y a une dizaine d’années, j’avais vu ici un western réalisé par Claude Fournier avec Donald Sutherland et Jean Duceppe qui s’appelle Alien Thunder (1974). C’était sorti à une époque où ça ne se faisait pas, mais il y avait des perles rares de cinéma de genre de temps en temps dans la programmation de la Cinémathèque. Je suis allé voir ce film-là qui était littéralement un western spaghetti. Donald Sutherland y joue une police montée. La salle était complètement pleine, et il y avait autant des vieux qui avaient vu ce film-là une fois à l’époque que des jeunes cinéphiles comme moi qui étaient comme : « C’est quoi ce film-là ? ». La Cinémathèque était quand même gutsy. Elle essayait. Elle sortait un ou deux films complètement fous, une fois de temps en temps.
David Fortin : Il y a eu une initiative de programmation, il y a plusieurs années, avant même que j’y travaille qui s’appelait Les nuits psychotroniques17 et qui avait lieu, je pense, les vendredis. Je pense que ça marchait bien et qu’aujourd’hui, certains programmateurs vont vers ça, d’autres moins. Ça bouge selon les époques. Ça essaie comme ça peut.

La sexualité et la violence dans le cinéma de genre
Louis Pelletier : Je pense que ça permet peut-être de rebondir sur la question : c’est quoi une bonne expérience de cinéma de genre ?
Francis Ouellette : Il y a une affaire à laquelle je réfléchis beaucoup : on dirait que plusieurs des basculements culturels et des évolutions cinématographiques les plus importantes qui ont eu lieu au sein du septième art n’auraient pas eu lieu sans la pornographie. Parce que la pornographie arrive et change les mœurs de la consommation du cinéma à une échelle démesurée. C’est la pornographie qui a créé le vhs. Le dvd aussi ; à tout le moins, la pornographie y a, dans le dernier cas, énormément contribué. Je me demande jusqu’à quel degré l’histoire du Québec ou du cinéma québécois au complet perdrait l’un de ses plus gros tentacules si on lui retirait Valérie (Denis Héroux, 1969) ? Valérie a l’air super innocent comme film, mais c’est un film qui a bâti à lui seul une industrie. Cinépix n’aurait pas existé sans ce film. Il aura donc fallu le film de cul ou le film folichon pour en arriver là. Tu vas d’ailleurs trouver plein de Québécois assez jeunes, capables de citer La pomme, la queue et les pépins (Claude Fournier, 1974). On redécouvre des films qui étaient considérés comme des blagues, mais qui sont maintenant pris au deuxième puis au troisième degré. Ces films sont des délices culturels que l’on récupère.
Julie Ravary-Pilon : Mais Valérie est aussi arrivé immédiatement après la fin de la censure18. Y‑a-t-il un lien direct entre la fin de la censure et la naissance d’une industrie « commerciale » du cinéma québécois ?
Eva Létourneau : Bien, pour avoir inspecté beaucoup de copies de films érotiques/pornographiques, je peux dire qu’on le voit directement : il y a des copies qui ont le visa de censure et d’autres pas. Et d’une copie à l’autre, il manque des plans. Même chose pour les bandes-annonces : la bande-annonce de ces films dure 30 secondes de moins. Ça représente tout de même un problème de conservation puisque les copies sont complètement charcutées et parfois de façon absolument ridicule.
David Fortin : On parle du Bureau de la censure, mais je pense à autre chose. Il y a plusieurs exemples qui démontrent bien comment la réception du film de genre s’est transformée avec le temps. Je pense à un organisme comme Mediafilm19. Tu regardes les premières fiches de Night of the Living Dead (George Romero, 1968), par exemple, qui était coté 6 ou 7. La petite fiche détruisait le film, essentiellement. Tu regardes maintenant sur leur site web et le film a été révisé. Il est maintenant 4 ou 3, je ne sais plus. Mais clairement, il y a une switch qui fait qu’on est passé d’un très mauvais film à un bon film. Il y a plusieurs autres exemples où l’on peut voir, justement, de quelle manière, la réception d’un film par des organismes comme Mediafilm ou le Bureau de censure s’est transformée avec le temps.
Mathieu Li-Goyette : Ou comme dans le cas de la revue Séquences. Je veux dire, Léo Bonneville, c’était un Père religieux si ma mémoire est bonne20. C’est assez drôle. Je m’étais beaucoup intéressé à la réception du cinéma japonais au Québec. Il faut vraiment attendre les années 1960 et que Claude R. Blouin commence à écrire dans Séquences des articles du genre « Comment voir le cinéma japonais ? », qu’il se mette à défendre des films qui sont pourtant des chefs‑d’œuvre comme le Harakiri (1962) de Kobayashi en disant : « ce n’est pas un film trash, ce n’est pas un film violent, c’est un film qui porte sur une caste en particulier, c’est une réalité socioculturelle ». Il fallait vraiment qu’il sorte tout son petit change pour défendre des films qui sont aujourd’hui des piliers du cinéma japonais. Parce qu’à l’époque, les gens s’arrêtaient à deux choses : d’une part, l’exotisme et, d’autre part, la violence et la sexualité qui en accompagnaient l’idée. Je pense que la réception et le milieu des médias au Québec a énormément conservé de ses vieux plis, institués d’abord par Séquences puis par l’Office des communications sociales21 et Mediafilm22. Aujourd’hui, on lit Cassivi ou Lussier dans La Presse ou même les gens du Devoir et c’est hallucinant à quel point j’ai l’impression qu’ils s’offusquent davantage sur des bases de petite moralité que sur des enjeux esthétiques formels. C’est fou à quel point ça ne parle jamais de mise en scène dans La Presse ou dans Le Devoir.
Francis Ouellette : J’ai parfois l’impression de revoir les réflexes de réception qu’il y a eu à l’époque d’Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 1959)23. Généralement, la représentation de la sexualité est très présente dans le cinéma de genre et beaucoup plus débridée que dans le cinéma d’auteur. Tu vas souvent avoir une charge sexuelle dans ces films-là, qu’elle soit symbolique ou littéralement montrée à l’écran. Le rapport que le Québec, dans son art cinématographique, a avec la sexualité, c’est un travail universitaire à faire de toute urgence. Nommez-moi, ces vingt dernières années, un film québécois qui montre une vision franche, saine, agréable, désinvolte de la sexualité. Il n’y en a pas ou à peu près pas. S’il y a de la sexualité, généralement, ça va lorgner vers l’inceste, vers le viol ou une sexualité qui est vécue avec une série de fétichismes ou avec des paraphilies.
Mathieu Li-Goyette : Ou alors, c’est apathique, à travers une sexualité ennuyée.
Francis Ouellette : Tout à fait. La sexualité, elle est ennuyée. Elle est morne, elle est molle et quand elle est dure, elle est dans l’agression la plupart du temps.
Mathieu Li-Goyette : C’est rough comme dans Laurentie (Mathieu Denis & Simon Lavoie, 2011).
Francis Ouellette : Complètement. Je pense à un film comme Nuit #1 (2011) de Anne Émond, que j’aime beaucoup ou même à Les salopes ou le sucre naturel de la peau (Renée Beaulieu, 2018). C’est un genre de sexualité qu’on ne voit pas souvent dans notre cinéma, mais ça demeure très froid, clinique, il n’y a pas de plaisir non plus.
Simon Chénier : Si on parle de mauvais genres, il y a aussi Échangistes (Simon Boisvert, 2007). C’est une autre version de la sexualité, mais vraiment mal représentée.
Francis Ouellette : Et qui, étrangement, rejoint un peu le cinéma d’auteur. Même chez un gars comme Boisvert, qui est une industrie à lui tout seul avec son cinéma culte, on est à la même place que tout le monde avec la sexualité. J’ai l’impression que l’absence d’une véritable industrie du cinéma de genre a fait que dans le cinéma, la représentation de la sexualité n’est pas très présente. Ou du moins, elle n’est pas positive.
Mathieu Li-Goyette : Même chose avec la violence ; c’est-à-dire que la violence dans le cinéma québécois, elle n’est jamais cathartique comme elle peut l’être dans un Tarantino. Ça va être un truc qu’on doit endurer ou quelque chose qu’on doit cacher ou qui va amener, comme dans Les sept jours du talion (Podz, 2010), une manière d’accuser le personnage.
Louis Pelletier : J’aime bien montrer Gina (Denys Arcand, 1975) à mes étudiants. C’est Cinépix qui a produit le film la même année que Ilsa, la louve des SS (Don Edmonds, 1975). En somme, c’est Denys Arcand qui s’amuse avec les codes du rape and revenge. Il y a une charge cathartique à la fin quand les violeurs se font exploser – il y en a qui passent dans le chasse-neige –, mais même là, le côté génial du film, c’est qu’il subvertit la dimension cathartique, car les types qui arrivent en sauveur, ce sont les mêmes types que tu as vu battre une femme dans la séquence d’ouverture du film. Tu penses alors « yes, le méchant passe dans le chasse-neige ». Mais non, en fait, le type qui le poursuit, il est aussi sale. Même quand Arcand joue avec les codes de cinéma de genre, c’est pour te faire sentir mal et pour enlever la charge cathartique.
Mathieu Li-Goyette : Mais alors que justement, si on revient à l’exemple de Turbo Kid, ça, c’est un film qui se voulait aller justement à plein gaz vers cette catharsis jouissive. Et justement, ça a été un film très mal reçu, très mal compris.

Écosystèmes médiatique et critique
Julie Ravary-Pilon : Un critique de cinéma de genre au Québec, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les implications liées à cette pratique ? Quelles en sont les spécificités dans un marché plus petit qu’aux États-Unis ? Qu’est-ce qui a changé en dix ans ?
Mathieu Li-Goyette : Il faut dire qu’il y a un problème dans l’écosystème médiatique québécois. Comme n’importe quel écosystème médiatique, il fonctionne au consensus, mais le nôtre est particulièrement pervers. Des médias comme La Presse et Le Devoir vont vouloir, au niveau de leurs critiques de cinéma, tenter de défendre un cinéma d’une certaine qualité en essayant justement de se tenir un peu à distance du genre parce qu’ils se voient, eux, en tant que média généraliste respectable, comme une forme de rempart aux films de genre. Et parce qu’ils se voient comme une forme de rempart, il n’y a aucune place à l’intérieur de ces publications pour une forme de voix minoritaire. Que ce soit par rapport aux genres ou par rapport à n’importe quel autre type de cinéma, on pourrait dire la même chose du documentaire ou de l’expérimental. Quel est la place du cinéma documentaire dans les pages du Devoir ? Il est peu présent, sauf quand le sujet du film s’accorde à l’air ambiant. Et lorsqu’il l’est, très peu proposent de lire le film à travers ses qualités formelles cinématographiques. Il y a un manque de diversité de médias. On est concentré autour d’essentiellement deux médias au niveau de la réception cinématographique, soit La Presse et Le Devoir, et Mediafilm, d’une autre manière. Puis ces trois organes-là avec Radio-Canada, cultivent une même forme de regard et s’entendent à peu près tous sur les mêmes films. Ils vont donner à peu près trois étoiles et demie à tout ce qui est local et qui va sortir en salle, sans non plus donner de coup de gueule. J’ai l’impression qu’au Québec, cette culture consensuelle fait que « péter sa coche », ce n’est pas bien vu. Et pour défendre le cinéma de genre, il faut être plus passionnel.
Francis Ouellette : On n’est pas de l’école de la critique française.
David Fortin : L’histoire de l’écriture critique sur le cinéma de genre, de toute façon, s’est développée tellement lentement. On peut partir de l’Europe avec une revue comme Midi-Minuit Fantastique qui s’ouvrait au cinéma de genre. Après, il y eu L’Écran fantastique et compagnie. Maintenant, nous avons des sites Web spécialisés. Pour ce qui est du Québec, on a Horreur Québec qui couvre massivement depuis plusieurs années tout le cinéma d’horreur qui est distribué ici.
Francis Ouellette : C’est drôle comment une certaine critique essaie quand même de désamorcer le brouillage des genres. Tu vas avoir des critiques qui vont utiliser, ces dernières années, le terme elevated horror pour parler de ces films d’horreur d’auteur. Or, je pense que les réalisateurs que ce terme désigne ne veulent pas de cette catégorie. Pour eux, ça n’a aucun sens de se faire dire que c’est du elevated horror.
Mathieu Li-Goyette : L’elevated horror, c’est un terme de marché du film, un terme vendeur qui, pour faire le tri, va accrocher des distributeurs plus sérieux, plus prestigieux, qui vont tout de suite dire : « oui, celui-là, c’est un film d’horreur, mais il n’est pas comme les autres, c’est un elevated horror ». C’est comme une espèce de stamp auteuriste qui finit par filtrer jusqu’à la littérature, jusqu’à la critique de cinéma.
En tant que critique, ce qui me déprime dans le fond quand je vais dans les festivals ou quand je critique des films de genre ou quand j’essaie d’avoir un angle particulier, c’est qu’étant basé à Montréal, on se pose très souvent des questions quant à savoir qui est notre lectorat, qui aime nous lire. J’aimerais aussi qu’on puisse étendre notre lectorat. Et je me dis qu’à côté d’une critique portant sur un Carlos Reygadas, il va y avoir un film de genre et puisque les deux sont traités avec le même sérieux et qu’ils ont eu le même espace éditorial – ça a toujours été un peu comme une espèce d’utopie –, qu’il y aura peut-être une forme de transvasement d’un public vers l’autre. Mais à notre époque, Internet fait que le genre crée des espèces d’hypersavoirs hyperconnectés où tout le monde sait. Depuis Nanarland,24 depuis Les douteux25, il y a toute une culture qui fait qu’on le possède bien, maintenant, cette espèce de patrimoine du cinéma bis. Ce qui fait maintenant en sorte que tout le monde est de mèche et qui permet l’émergence d’une nouvelle capitalisation sur ce marché-là qui se construit sur la nostalgie, qui se construit sur une espèce de désir de pouvoir reproduire ces expériences cinéphiles-là et d’être capable de les marchandiser.
Francis Ouellette : Comme pour Ready Player One.
Mathieu Li-Goyette : Oui, mais avant ça, je pense qu’un des films qui a été vraiment moteur dans cette évolution-là, ça a peut-être été aussi le Grindhouse (2007) de Tarantino et Rodriguez qui a été diffusé at large en programme double. Et là, depuis, Shudder26, avec ses espèces de nuits drive-in animées par Joe Briggs, essaie aussi de reproduire ce type d’expérience-là, mais à travers la VSD, à travers le service de streaming. Quand je regarde le travail du collectif de cinéastes Roadkill Superstar, ce qu’ils ont fait avec Turbo Kid, ce qu’ils ont fait avec Summer of 84 (François Simard, Anouk Whissell & Yoann-Karl Whissell, 2018), on est encore une fois dans un désir de capitaliser sur un mauvais genre, dans une espèce de zone qui est super bizarre et vraiment aliénante parce qu’il y a un talent cinématographique qui est véritablement mis de l’avant, qui est déployé, on le voit. En même temps, c’est utilisé pour essayer de pasticher une esthétique qui était mauvaise, mais qui était mauvaise à ses dépens. Les gens dans les années 1970 qui faisaient ces films-là, j’imagine qu’ils mettaient du cœur à l’ouvrage. C’était tout croche, il y avait des contraintes de tournage complètement débiles où ils devaient faire des longs métrages en une semaine et ça donnait ce que ça donnait. Alors qu’aujourd’hui, on est dans une époque extrêmement capitaliste qui essaie de reproduire ça de manière super artificielle… Bref, ce qui me déprime en tant que critique par rapport à ce paradigme-là, c’est de me sentir pris. Par exemple, j’ai eu à critiquer Turbo Kid. Et j’ai aussi critiqué Les affamés, qui n’a pas du tout les mêmes défauts Mais dans les deux cas, j’étais un peu déchiré parce que je me disais : « ce ne sont pas des films que j’aime d’un amour intense », tout en me demandant où nous étions rendus, au Québec, par rapport à notre perception du genre. C’est le fun que Turbo Kid ait été produit, c’est le fun qu’on ait produit Les affamés. Mais j’aimerais ça qu’on ait quinze films de genre produits au Québec par année et qu’on en ait suffisamment pour que je puisse me donner la liberté de critiquer un film d’horreur, par exemple, que je trouve assez moyen, sans être aveugle à ses défauts sous prétexte que je souhaite le succès du film. Et je souhaite que le film marche parce qu’idéalement, si c’est le cas, ça peut possiblement envoyer un signal aux subventionnaires comme quoi on pourrait avoir une industrie du genre au Québec. Cette espèce de perception critique est constamment faussée parce que, parallèlement, Arrow publie plein d’affaires, parce que Severin fait ce travail-là, si bien que les cinéphiles fans de genre ont acquis des goûts assez aiguisés. Bref, on est rendu assez loin dans notre connaissance du genre. Internet fait que cette espèce d’écart entre ce public cinéphile qui aime le cinéma de genre et la masse publique québécoise s’est creusé à une vitesse phénoménale. L’écart entre ces deux publics-là, à mon sens, est bien plus grand aujourd’hui qu’il ne pouvait l’être quand j’ai commencé à faire de la critique il y a dix ans. Moi, personnellement, en ce moment, quand j’écris sur des films de genre, je me sens vraiment tiraillé par rapport à ce que mon regard de cinéphile de genre voit et mon rôle en tant que critique – au sens de la toute petite place qu’on peut occuper dans l’écosystème cinématographique au Québec. Est-ce qu’on y va vraiment franchement au risque de s’aliéner le grand public québécois puis les subventionnaires qui ne sont pas plus des fans de cinéma de genre en général ? Ou est-ce que, justement, on ravale ces perspectives critiques-là en se disant : « OK, on va essayer de le faire pour, je ne sais pas moi, le bien commun du genre ? »
Julie Ravary-Pilon : Mais dans ce cas, est-ce que ça revient aux « systématiques » trois étoiles et demie attribuées aux productions québécoises auxquelles tu faisais référence plus tôt ?
Mathieu Li-Goyette : J’ai donné trois étoiles et demie à Turbo Kid et aux Affamés. C’est sûr que les réticences que j’avais vis-à-vis de Turbo Kid et des Affamés, je ne me serais jamais gêné pour les écrire au sujet d’un film japonais, américain ou allemand.
Louis Pelletier : C’est peut-être se poser la question : est-ce qu’on fait la critique d’abord et avant tout pour le spectateur de 2019 qui se demande s’il va mettre treize dollars sur le dernier film d’untel ou d’unetelle, ou si l’on travaille pour construire une cinématographie nationale ?
Francis Ouellette : Tu viens de toucher le nerf de la guerre qui interpelle les distributeurs. Au bout de la ligne, c’est le même montant d’argent investi par le citoyen et cette dimension-là, elle est fondamentale. Ça rejoint ta question par rapport aux critiques. C’est un point de vue quand même assez important. Quand tu regardes la majorité de la cinématographie québécoise et que tu essaies de la placer sur un échiquier d’équivalences internationales, plusieurs de ces films-là ne sont intéressants que chez nous. Il n’y a aucun intérêt à l’international. Ils ne font que stimuler l’intérêt national et tous les pays ont leur cinématographie nationale qu’on ne connaît pas. L’Allemagne sort vingt films de comédie folichonne de cul par année. Mais nous, on s’enorgueillit, on est obsédé à l’idée que le moindre des films qui se fait au Québec, il faut qu’il ait une vie à l’étranger. Ben non. Certains de ces films-là, exactement les mêmes dans un autre contexte socioculturel, sont sans conséquence. C’est assez surprenant qu’une province ait une cinématographie qui intéresse plus l’international. Déjà là, c’est un privilège. À l’international, le cinéma québécois, c’est le cinéma canadien pour les festivals si on exclut Egoyan, Guy Maddin et David Cronenberg. C’est quand même assez exceptionnel et ça ajoute une coche sur la crise identitaire. Je vous dirais même que si un analyste de cinéma d’un autre pays regardait notre cinématographie maintenant et qu’il se mettait à essayer de faire une espèce de psychanalyse de ce que notre culture va devenir, il vous dirait : « ça fait dix ans que je regarde du cinéma québécois et le cinéma québécois parle de son imminente disparition et agonie ». Les Québécois ont peur de disparaître et leur cinéma, même en filigrane, même au troisième degré, ne parle que de ça.
Julie Ravary-Pilon : Est-ce que c’est pour ça qu’on n’a pas de sexualité dans le plaisir ?
Francis Ouellette : Probablement. On ne peut pas se reproduire, on n’a pas de plaisir. Avez-vous remarqué comment le cinéma québécois répond également souvent d’une certaine filiation avec la nordicité, mais sans aucune exaltation ? Tu vas trouver dans le cinéma islandais, dans le cinéma danois, une exaltation propre à la nordicité que tu ne trouves pas au Québec, ici elle n’est qu’une morgue, qu’une souffrance. Et j’ai distribué certains de ces films-là. Ça n’a rien à voir avec la Scandinavie. On a notre propre nordicité ici.
L’homme rapaillé de Gaston Miron (1970), à la base, le titre original de ce recueil de poésie-là, c’était La vie agonique. Le Québécois mène très souvent une vie agonique. Ça le représente assez bien. Pas trop d’exaltation depuis Gilles Carle et Forcier et ce n’est certainement pas dans les derniers Forcier que l’exaltation va être apparente. Ils sont où nos prochains Forcier et nos prochains Gilles Carle ? Les voit-on quelque part ? En tant que distributeur, je ne les vois pas. Je lis cent scénarios par année et je n’en vois aucun. Il va falloir qu’il se passe quelque chose.

Accessibilité : où chercher, où trouver, le numérique
Louis Pelletier : J’aimerais revenir vers Simon puisque que l’on parle d’homogénéité dans les médias, dans les discours autour du cinéma. Je pense que l’ouverture sur le cinéma de genre et les autres cinémas nous permet présentement d’avoir en tête une grande diversité d’œuvres que les médias mainstream et même les histoires officielles du cinéma québécois ne nous ont pas transmise. À travers Simon et son travail de chercheur, j’ai découvert des tonnes de trucs. Je vais poser la question à Simon d’abord. Ensuite, on pourra élargir. Je serais curieux de savoir comment tu fouilles, comment tu trouves ?
Simon Chénier : Bonne question. C’est sûr qu’avant, je faisais le tour des clubs vidéo, tout simplement.
Louis Pelletier : La vhs, je pense que c’est important.
Simon Chénier : Oui, en effet. Puis on parlait plus tôt de la distribution, disons qu’ici, on essaie souvent d’avoir la version française sans quoi on n’écoute pas les films. Beaucoup de films sont oubliés parce que maintenant, les Blu-ray n’ont pas la version française. Et alors, ces films-là, en français, deviennent des vhs. Autour des films de mauvais genre, il n’y avait pas beaucoup d’informations qui circulaient, autrefois. Tu trouvais une vhs, tu cherchais le nom. IMDb n’était pas complet encore. À un moment, je suis tombé sur le site d’un gars qui faisait des critiques de ces films-là. J’ai commencé à faire des liens par cette entremise et entre-temps, il y a Nanarland qui est arrivé, un site qui m’a fait découvrir beaucoup de choses. Depuis ce temps-là, les clubs vidéo sont morts. Quand tu regardes sur Google Maps, tu vois un club vidéo, tu y vas et là, il y a du papier brun dans les vitres parce que ça n’existe plus depuis deux ans. Maintenant, tu peux juste chercher par le Net pour découvrir du nouveau stock. Et il y a tellement de monde maintenant qui s’intéresse à ça qu’il y a encore plus d’informations. On trouve de l’information sur le making of de certains films qu’on ne pensait jamais avoir. Les guerriers du Bronx (Enzo G. Castellari, 1982) par exemple. Le fait que j’aie un Blu-ray avec un commentary track de Castellari qui m’explique : « ah ouais, le drummer qui joue là, sur le bord de la plage, il était là quand j’ai fait du scouting pour la place et j’ai décidé de le reprendre ». Quand j’ai regardé ce film-là, je me suis demandé pourquoi il y avait un drummer là et là, j’ai une explication. Je n’aurais jamais pensé ça.
David Fortin : Tu passes d’un vhs qu’on regarde entre amis à une édition Blu-ray restaurée avec un million de suppléments. Entre-temps, les gens qui s’y intéressaient se sont mis à écrire à son sujet, à créer des blogues et des sites Web. Tranquillement, il y a de plus en plus d’informations qui circulent et de plus en plus de monde qui va découvrir ces films-là. Ça fait un effet de boucle. Et puis, tu as des gens comme Sacha Lebel qui vont venir à la médiathèque éplucher les archives de Cinépix pour écrire une thèse de doctorat sur les comédies populaires au Québec27. Ou encore des gens comme toi, qui collectionnent les vhs ou qui ne font pas encore le pont avec le Blu-ray, peu importe, qui décident de numériser ça maison et de rendre disponibles les films sur une chaîne YouTube.
Simon Chénier : Tu as des chaînes YouTube qui analysent ces films-là maintenant.
David Fortin : Tout à fait. Avec les podcasts, aussi, il y a comme une communauté qui se crée.
Louis Pelletier : D’un point de vue archivistique, si un distributeur comme Arrow veut sortir un film, ou si une cinémathèque veut restaurer un film, on dirait que c’est tout ou rien, c’est-à-dire que c’est soit un Blu-ray, numérisé en 4K avec édition critique et suppléments, ou rien du tout. C’est donc bien d’avoir des collectionneurs qui vont rendre les choses disponibles. C’est bien d’avoir la totale, mais je pense que ça fait partie de l’expérience du cinéma de genre et du cinéma d’exploitation de le voir dans des conditions un peu particulières (la copie 35 mm virée et rayée, la cassette vhs, etc.).
Simon Chénier : Se poser des questions aussi, c’est une grande partie du fun à avoir du mauvais genre. Quand tu regardes un film, tu te dis : « pourquoi ils ont fait ça ? »
Louis Pelletier : Personnellement, je suis curieux par rapport au cinéma de genre et au cinéma d’exploitation culte, mais ce n’est pas mon intérêt principal. Les quelques fois où je suis allé aux Douteux ou même à Fantasia, c’était presque par défaut. Et puis, c’est souvent la dérision qui l’emporte. Ce que j’adore de l’approche de Simon, c’est que c’est une approche ouverte, curieuse, qui accepte que ça puisse être magique de ne rien comprendre.
Simon Chénier : Ma vision a changé aussi. Au début, je me moquais beaucoup. Maintenant, j’apprécie. J’essaie de comprendre, mais parfois, je ne comprends rien. Et puis, j’ai du fun avec ça.
David Fortin : On disait que c’est le fun de regarder les films dans des conditions spéciales, mais de la même manière, on peut les redécouvrir quand ils sont projetés, restaurés. Je me rappelle quand la Cinémathèque a projeté Les mutants de la deuxième humanité (Bruno Mattei, 1984) en 35 mm – une copie qui était vraiment belle. J’ai redécouvert le film en me disant : « Wow, OK, le cadrage est génial et la photo est vraiment belle ! » Je veux dire, ce n’est pas un grand film, mais techniquement, ça a de la gueule. C’était surprenant de le redécouvrir de cette façon-là.
Francis Ouellette : N’est-ce pas un drôle de paradoxe que les fans de cinéma de genre qu’on associe à des collectionneurs de vhs, des gens qui font du streaming, téléchargent, s’intéressent à des films super rares, à une époque où tout le monde s’inquiète de la désertion des salles ? J’ai l’impression que ce type de cinéphiles-là va contribuer à garder leur magie. Il y a aussi les gens qui aiment le cinéma classique, mais je veux juste dire que la magie de la projection comme Fantasia, ce que tu disais tout à l’heure, la magie de la projection collective avec la frénésie qu’elle génère, c’est ce genre de truc qu’ils entretenaient aux Douteux. Il fallait y être pour comprendre, c’était un peu cinglé. Tu réécoutes tout seul chez vous Le ninja de Beverly Hills (Dennis Dugan, 1997) et ce n’est pas la même chose.
David Fortin : C’est l’expérience en salle commune. Plusieurs plateformes de VSD sont apparues maintenant, aussi spécialisées que l’est Arrow pour les dvd, mais les plateformes comme Shudder qui se spécialisent dans le cinéma de genre produisent des films comme Mandy (Panos Cosmatos, 2018). Le film était voué à sortir directement sur Shudder, mais suite à la demande, il y a finalement eu une sortie en salles et ça a très bien marché pour un film qui n’était pas supposé sortir en salles. Donc, on voit que l’intérêt des amateurs de cinéma de genre va au-delà de Shudder. Ils veulent aller le voir en salles, vivre cette expérience-là. Et puis, les cinéastes qui font maintenant des films de genre s’appuient sur des films qui réfèrent beaucoup à un certain cinéma des années 1980 avec lesquel ils ont grandi. Ils ont aussi grandi avec plein d’autres cinémas et ils incorporent un peu toutes ces influences-là. Il n’y a plus que des traces du genre dans ces films, les films se retrouvent plutôt finalement enveloppés dans le genre. Ça donne quelque chose qui est un peu à côté, comme le film It Follows (David Robert Mitchell, 2014) qui fait énormément penser aux films d’horreur des années 1980. Et puis le nombre de cinéastes qui se disent aujourd’hui être influencés par John Carpenter. Ce nom-là revient constamment.
Julie Ravary-Pilon : On a évoqué à plusieurs reprises la question de la communauté. Il y eu un changement avec le numérique. Le numérique a permis de rassembler des informations, de créer de nouvelles communautés de fans.
David Fortin : Je te dirais qu’en faisant beaucoup de recherches sur les films qu’on aimerait projeter, j’aime souvent creuser sur Internet à propos de films ou d’informations que je n’arrive pas à trouver ailleurs. Je pense à Le prince Nezha triomphe du roi Dragon de Wang Shuchen, film d’animation de 1979, que j’essaie de trouver depuis deux ans, et tous les trucs sur lesquels je suis tombé étaient issus des forums de personnes qui, justement, travaillent dans des collections de films, à la projection de films en pellicule ou dans les cinémathèques ou les ciné-clubs. Il y a également des cas où il n’y a pas de copies 35 mm ou pour lesquels on ne retrouve que des vieux transferts VCD qui circulent en Asie. Donc, ces endroits-là, ces regroupements de communautés virtuelles (et peut-être les réseaux sociaux maintenant) servent, j’ai l’impression, à continuer le travail de recherche.
Eva Létourneau : Via le numérique, même les institutions ont plus facilement accès aux catalogues des autres institutions et, de là, se posent des questions entre elles, notamment dans le cas des co-productions où il faut faire des vérifications avec les autres pays.
David Fortin : Il y a aussi eu cette époque où Internet était moins contrôlé. On pouvait trouver des sites sur lesquels des cinéphiles donnaient accès à plusieurs films rares ou moins accessibles.
Simon Chénier : Je peux donner deux exemples marquants. D’abord, il y a un film très connu chez les gens qui trippent sur les films de mauvais genre, c’est le film Deadly Prey (David A. Prior, 1987), un film d’action très de base, inspiré par Rambo (David Morrell, 1982). À un moment, le réalisateur ou les gens autour de lui se sont rendu compte qu’il y avait un intérêt pour ce film-là. Plus ça allait, plus les gens en parlaient. Le réalisateur a donc essayé de partir un Kickstarter28 pour faire une suite trente ans plus tard et ça a marché, avec Deadliest Prey (2013). Le film est vraiment mauvais et c’est exactement le même film sauf pour un élément : on surveille le héros par Internet. Il y a aussi le fameux Samourai Cop (Amir Shervan, 1989), le samouraï de Los Angeles. L’acteur principal avait disparu de la carte et à un moment, une vidéo est sortie sur le Web où il disait : « oui, j’existe encore. Vous trouvez ce film drôle et moi aussi ». Un autre Kickstarter a alors permis de produire Samourai Cop 2: Dearly Vengeance (Gregory Hatanaka, 2015).

Films de genre, films cultes du Québec
Julie Ravary-Pilon : En faisant un tour de table, je vous demanderais quelles sont vos références québécoises de mauvais genre. J’aimerais vous entendre parler de votre film préféré, mais aussi des cinéastes que vous suivez dans l’écosystème médiatique québécois des mauvais genres.
David Fortin : Je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu, au Québec, un cinéaste qui se soit à ce point-là lancé dans le genre et qui ait développé une filmographie conséquente, mais on doit beaucoup à Jean-Claude Lord et à Yves Simoneau. Ce sont peut-être les premiers cinéastes qu’on a commencé à remarquer parce qu’ils étaient plus massivement distribués, autour de films qu’eux considéraient, je pense, dans certains cas, comme des films de « commande ». Mais ils tentaient le genre, justement. Je pense à The Vindicator (1986) de Jean-Claude Lord, qui est un Robocop (Paul Verhoeven, 1987) avant le temps. Ça se passe à Hochelaga avec Pam Grier. C’est un film de cyborg très surprenant. Tu as des films d’Yves Simoneau comme Les yeux rouges (1982) qui est vraiment un genre de De Palma weird, un peu fantastique ou on peut aussi penser à Dans le ventre du dragon (1989). Si on recule un peu plus loin, des cinéastes comme Gilles Carle ont quand même un peu touché au genre. On pense par exemple à Red (1970).
Francis Ouellette : Red est absolument un jalon fondamental de l’évolution du cinéma de genre qui n’est pas assez évoqué. Ce film-là « prédatait » la Blaxploitation. Tu regardes le film et il y a vraiment tout le swagger, toute l’essence d’un film de Blaxploitation. Ce n’est pas le film de Gilles Carle dont on parle dans sa cinématographie, parce que c’est probablement celui qui est le plus genré, justement.
Mathieu Li-Goyette : Un film comme La mort d’un bûcheron (Gilles Carle, 1973), c’est très western.
Louis Pelletier : Et Carle va chercher des icônes de la culture québécoise. Dans Red, il y a Gratien Gélinas qui apparaît ; dans La mort d’un bûcheron, Denise Filiatrault et Willie Lamothe.
Francis Ouellette : Je me permets de sauter sur Mustang, qui présente la stratégie dont tu parles, qui consiste à aller vers le populaire, la variété, le monde du cabaret et de la musique. Quels sont les films qui fonctionnent le plus au Québec en ce moment ? Ils ont encore la même formule. Ils vont chercher un comédien de théâtre, un humoriste ou un animateur de télé.
Louis Pelletier : Jean Lapointe, c’était quelqu’un de cabaret avant d’être dans Les ordres (Michel Brault, 1974).
Francis Ouellette : Et n’a‑t-il pas donné parmi certaines des plus belles interprétations du cinéma québécois ? J’ai l’impression que le cinéma qui fonctionne encore de nos jours va dans cette zone-là. Prends deux ou trois acteurs de Like-moi (Télé-Québec, 2015–2020), un chanteur populaire et un acteur légitime, et tu vas avoir un succès populaire. Mais pour l’instant, la recette Cinémaginaire, c’est vraiment une recette. Ils la répètent jusqu’à leurs affiches et leurs bandes-annonces qui ont le même timing et qui ont le même design. Et il faut avouer une chose, ça fonctionne.
Julie Ravary-Pilon : On peut penser à Émile Gaudreault plus qu’à Cinémaginaire parce que c’est Cinémaginaire qui fait encore tout Arcand quand même.
Francis Ouellette : Ta nuance est fondamentale. Émile Gaudreault.
Julie Ravary-Pilon : Oui, Émile Gaudreault et Cinémaginaire, les gros succès, c’est encore Bon Cop, Bad Cop, ce sont les films policiers. D’un côté peut-être plus contemporain, on peut penser à la première production québécoise de Netflix, qui sera un thriller nordique, Jusqu’au déclin (Patrice Laliberté, 2020).
Francis Ouellette : Le scénariste, Nicolas Krief, traîne ce scénario-là depuis des années et les institutions lui disaient, avec une certaine condescendance : « Ça, c’est le genre de stock que Netflix prendrait ». Ils y sont allés et c’est ça qui s’est passé. Mais en cinq ans, les choses ont un peu changé.
Eva Létourneau : Je pense pour ma part à Panique (Jean-Claude Lord, 1977), Visiting Hours (Jean-Claude Lord, 1982), Les yeux rouges, dans les gros films. Mais aussi à Elvis Gratton (Pierre Falardeau et Julien Poulin, 1985), qui est un grand film culte québécois. Je revois la scène où il se bat avec sa chaise sur la plage en maillot de bain avec le drapeau du Canada et l’autre où il essaie d’expliquer qu’il est un Canadien français d’expression française américain. Il y a un gars dans l’avion qui ne comprend rien de ce qu’il dit.
Louis Pelletier : C’est un cas intéressant parce que culte, puis auteur, généralement, c’est exclusif. Un film d’auteur, ce n’est pas un film culte.
Eva Létourneau : La réception est importante. Elvis Gratton, c’est un film qui a été pris pour une comédie alors que ce n’était pas si drôle que ça. C’est plutôt déprimant. C’est quand même un vieux dégueulasse complètement con. C’est drôle, mais ce n’est pas drôle. Ce côté-là, pour moi, en fait un film culte.
Francis Ouellette : C’est un peu comme un éventail, un spectre, qui va d’un mauvais genre mauvais et d’un mauvais genre bon. Pour moi, c’est La pomme, la queue et les pépins. Je peux le regarder chaque semaine.
Julie Ravary-Pilon : Est-ce que c’est mauvais ou c’est bon mauvais ?
Francis Ouellette : C’est mauvais mauvais et c’est magnifique. Ce film-là n’est pas un film, c’est l’héritage du cabaret québécois dans tout ce qu’il a de plus vulgaire et cru. Il y a des lignes, là-dedans, que tu lis aujourd’hui et tu te dis : « Je ne suis même pas censé dire ces choses-là. Je ne peux pas dire ça. » Avec La pomme, la queue et les pépins, je dirais qu’on reste dans le vulgaire, mais que l’on tombe dans le culte profond comme avec Elvis Gratton. On commence à se raffiner un peu, mais dans un absurde de type Denis Drolet, avec Ding et Dong, le film (Alain Chartrand, 1990). Ce film-là est culte à un niveau qui n’a aucun sens au Québec. Les gens connaissent les lignes par cœur et c’est un étrange film, un ovni complètement déstabilisant. Pourquoi ce film-là ? Je ne le sais pas encore à ce jour. Dans l’autre spectre des films légitimisés, il y a IXE-13 (Jacques Godbout, 1971). C’est un cas unique dans la cinématographie internationale. C’est tellement particulier. On peut aussi penser au prochain film de Matthew Rankin, Le vingtième siècle (2019).
Mathieu Li-Goyette : Il y a quelque chose d’assez intéressant qui s’est produit à travers notre histoire du cinéma québécois. Je me demande à quel point les comédies québécoises vont dans le même tiroir que les autres films, dans la mesure où on a un cinéma commercial qui s’est beaucoup construit autour de la culture du cabaret et de l’humour. Aujourd’hui, c’est la culture mainstream. Menteur, c’est un film de genre, c’est une comédie, mais en même temps, ça ne répond pas du tout aux attentes des cinéphiles de genre.
David Fortin : Pour moi, le terme « genre » a toujours été un peu étrange. Tout peut passer pour genre. Si le genre, c’est juste les films d’horreur, c’est une autre histoire. Mais j’ai l’impression que dans le genre, on a les comédies, les films de science-fiction, etc.
Francis Ouellette : Peut-être qu’on pourrait considérer le clivage en utilisant l’appellation culture populaire ou culture pop. La comédie est le genre qui peut changer de bord comme il veut. Tu peux avoir un petit film d’auteur, un film de Stéphane Lafleur comme En terrains connus (2011) qui va jouer avec l’humour autant qu’avec la science-fiction d’une manière vraiment soft, à sa manière. On ne le classe pas nécessairement dans la catégorie des films de genre, mais ça joue là-dedans pareil.
Simon Chénier : L’affaire, c’est qu’on parle de mauvais genre, pas de genre.
Mathieu Li-Goyette : Je pense qu’il y a des mauvais genres et probablement des bons genres au sens institutionnel du terme. Autrement dit, qu’il y a des bons genres qui plaisent bien à la SODEC alors qu’il y a des mauvais genres qui ne plaisent pas du tout. En même temps, justement, c’est un non-sens. Tu ne fais pas une demande de subvention pour financer ton film psychotronique.
Francis Ouellette : Vous connaissez sans doute le réalisateur Ara Ball. Pas Fernando Arrabal, mais Ara Ball qui a fait le court métrage L’Ouragan Fuck You Tabarnak ! (2013)29. Un court métrage absolument improbable dans notre cinématographie qui rappelle le vieux cinéma, Forcier, Gilles Carle dans sa vulgarité, son agressivité, son énergie punk, mais que tu n’imagines plus, de nos jours, en long métrage. C’est agressif, c’est désespéré, c’est beau, c’est tendre, c’est violent. C’est un petit punk de l’Est dans les années 1990 qui lâche un « tabarnak » aux deux phrases et ce sont des rapports sexuels troubles et beaucoup de pauvreté, chose qu’on ne voit à peu près plus dans notre cinématographie parce qu’on parle de tout, sauf de la lutte des classes. Si la SODEC finance ce film-là, si Téléfilm Canada finance ce film-là, peut-être que ce sera un léger indicateur que quelque chose se passe, mais je ne sens pas ça soit dans les préoccupations contemporaines. Si vous n’entendez plus parler de L’Ouragan Fuck You Tabarnak !, ça veut dire qu’au Québec, on s’est prononcé : on ne veut plus de ce cinéma-là, on ne veut plus provoquer. On veut rester clean même dans nos émotions négatives. Des Elvis Gratton, ce n’est plus possible. Peut-être à la télé, c’est possible.
Simon Chénier : Moi, c’est sûr que je vais prêcher pour Simon Boisvert. Un cinéma d’auteur québécois, populiste, aussi. Ce n’est pas du grand art, mais c’est fascinant à regarder.
Francis Ouellette : En ce moment, il y a trois ou quatre personnes autour de la table qui peuvent vous citer des lignes de ses films parce qu’on les a vraiment beaucoup regardés. Il y a quelque chose dans ce cinéma-là qui ne ressemble à rien au Québec. Tu as tout à fait raison.
Simon Chénier : Son dernier film, Love or Lust (2017), il l’a fait totalement en anglais. Il joue un anglophone qui habite au Vermont – ce n’est pas très clair.
Francis Ouellette : Il vaut la peine. Particulièrement Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent (2001).
Simon Chénier : Ah, moi je dirais particulièrement Vénus de Milo (2002). Le film sur un faux band qui fait une tournée Montréal-Québec.
David Fortin : Simon Boisvert a une relation étrange avec le culte qui se développe autour de ses films parce que c’est le seul succès qu’il a. Il n’a donc pas vraiment le choix de l’embrasser, mais en même temps, ça le chicote parce qu’on l’aime, mais en même temps on en rit un peu. Il doit dealer avec ça. En tous les cas, ça reste un des excellents exemples de cinéastes qui ont fait une œuvre devenue culte.
Francis Ouellette : Je pense que dans cet ordre de pensées-là, à Papa est devenu un lutin (Dominique Adams, 2018). En ce sens que si vous voulez un gars qui a réalisé un film, qui l’a mis sur YouTube, qui a voulu le sortir en salles après et qui l’a fait, on se retrouve avec des gars comme Boisvert et des gars comme Dominique Adams. Après, on est assez prompt à les condamner et à dire que ce sont des cinglés finis. Mais ce sont des gens vraiment industrieux qui ont envie que leur cinéma se voit.
Simon Chénier : Il y a quelque chose de culte, mais qui n’est pas mauvais genre, avec Prank (2016) de Vincent Biron.
Francis Ouellette : Il me semble que Prank devrait avoir tout ce qu’il faut pour devenir un film culte. C’est aussi l’affaire de scénaristes, comme Alexandre Auger… Éric K. Boulianne qui a aussi co-écrit Menteur. On ne parle pas beaucoup des scénaristes au Québec, c’est vraiment une denrée rare, mais Boulianne est quand même une valeur assez sûre, chez nous. Donc, oui, je suis tout à fait d’accord avec toi. Et puis, on n’a plus beaucoup de lignes citables, de citations de cinéma dans nos scénarios de nos jours.
Julie Ravary-Pilon : Est-ce que c’est un must pour les films de genre, les citations ?
Francis Ouellette : Je pense que oui. Dans Prank, il y a une ligne définitivement importante : « Qu’est-ce que tu veux que je lui achète ? Je vais lui acheter un chip au ketchup. Pourquoi ? Regarde-le ; il a la face d’un gars qui s’achète des chips au ketchup. » Quand Prank nous est arrivé, ça faisait 15 minutes que je l’écoutais et je voulais le distribuer.
Mathieu Li-Goyette : Pour ajouter à cette liste-là de gens à surveiller, moi, j’aime vraiment beaucoup le travail d’Olivier Godin. C’est un cas assez particulier parce qu’au niveau stylistique, il a un côté un peu plus Raoul Ruiz, Rivette même. C’est beaucoup de dialogues, c’est beaucoup de mises en abîme à l’intérieur de son scénario – les récits dans le récit –, mais ses influences, ce sont Suzuki, Conan le barbare (John Milius, 1982), les films de série B, le cinéma italien des années 1970. Il essaie toujours de les récupérer dans son cinéma. C’est très particulier parce qu’en plus, ça passe à travers un filtre du conte québécois qui est toujours très présent chez lui ; son amour de Ferron et de la culture orale ici. Je pense qu’à un moment donné, il va finir par peut-être l’assumer un plus de son côté « genre », mais je trouve qu’il y a quelque chose dans son cinéma qui est vraiment intéressant de ce point de vue.
Biographies des participants
Après avoir exercé les professions de loadeur de trucks, de clown, de père Noël de centre commercial, d’homme de ménage nu, d’éducateur en garderie, de commis de club vidéo, d’agent de sécurité, de scénariste de bande dessinée frustré, de poète raté et de critique de cinéma, Francis Ouellette est devenu directeur général de FunFilm Distribution. Son premier roman, Mélasse de fantaisie, paraîtra aux Éditions La Mèche à l’automne 2022.
Mathieu Li-Goyette est critique de cinéma et doctorant en littérature comparée à l’Université de Montréal. Rédacteur en chef de Panorama-cinéma, il a dirigé deux publications collectives sur le cinéma japonais pour la revue : L’humanisme d’après-guerre japonais (2010) et Nikkatsu : 100 ans de rébellion (2012). Programmateur de nombreux événements et rétrospectives cinématographiques à Montréal, il a été vice-président de l’Association québécoise des critiques de cinéma et programmateur invité à la Semaine de la critique de Berlin en 2018. Il est aussi chargé de cours au Centre d’études asiatiques (UdeM) où il enseigne alternativement l’anime, le manga et le cinéma japonais.
Eva Létourneau est responsable de la conservation des films et de l’audiovisuel à la Cinémathèque québécoise où elle travaille depuis 2016 et agit également à titre de programmatrice pour le Festival des films underground de Montréal (MUFF). Titulaire d’un baccalauréat en Film Production de l’Université Concordia et d’une maîtrise en Film and Photography Preservation and Collections Management de l’Université Ryerson, elle poursuit actuellement des études en archivistique.
Passionné de cinéma depuis l’enfance, David Fortin est documentaliste pour le centre de documentation de la Cinémathèque québécoise, un poste qu’il occupe depuis 2007. En 2013, il a rejoint l’équipe du 7ème antiquaire et depuis 2015, il tient la barre de l’émission musicale Planète sauvage sur CHOQ.ca. En 2016, il s’est joint à l’équipe de Panorama-cinéma à titre de directeur général.
Simon Chénier est technicien aux archives à l’Office National du Film, podcasteur, musicien et vidéographe. Depuis son adolescence, il baigne dans le film de genre et le format vhs, ce qui l’a poussé à étudier en technique d’animation 2D-3D et en gestion des archives.
Notamment connue pour avoir produit les films de Denys Arcand, Cinémaginaire est une compagnie de production fondée en 1988 par Denise Robert et Daniel Louis.↩
Les prix Aurore récompensent les pires productions et acteurs de l’année au Québec, reprenant le principe des Razzie Awards.↩
La liste des nominations pour la dixième mouture des prix est ici présentée : https://parici.radio-canada.ca/television/5701/INFOMAN-Presente-Le-10e-Gala-Des-Prix-Aurore (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Les mystérieux étonnants présentent depuis une quinzaine d’années des baladodiffusions consacrées à la culture populaire, https://www.mysterieuxetonnants.com/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Dans le cadre de l’émission de Christiane Charrette, une discussion tendue entre Alexandre Fontaine Rousseau et Franco Nuovo a eu lieu, à la suite de la critique de Fontaine Rousseau du film La chute de l’empire américain (Denys Arcand, 2018) parue sur le site de 24 images (2 juillet 2018), https://revue24images.com/les-critiques/la-chute-de-lempire-americain/ (dernière consultation le 4 janvier 2022). Le genre y était notamment discuté, avec pour présupposé chez Nuovo qu’il était une chose négative. « Denys Arcand fait-il du cinéma de mononc’ ? », Christiane Charrette (8 juillet 2018), https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/christiane-charette/segments/entrevue/79054/chute-de-l-empire-americain-franco-nuovo-alexandre-fontaine-rousseau (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Le 7ème antiquaire présente des baladodiffusions dédiées au cinéma, à la culture populaire et à la culture geek, notamment, https://www.choq.ca/emissions-details/7eantiquaire/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Arrow est un distributeur indépendant britannique spécialisé dans le cinéma international, d’art, d’horreur et classique, https://www.arrowfilms.com/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Severin Films est une société de production et de distribution américaine spécialisée dans la restauration et la diffusion de films cultes, https://severinfilms.com/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Élephant est un organisme québécois qui restaure, numérise et rend accessibles les longs métrages de fiction québécois, https://www.elephantcinema.quebec/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Vinegar Syndrome est une compagnie américaine de restauration et de distribution de films indépendants et de genre, allant des années 1960 aux années 1980. https://vinegarsyndrome.com/pages/about (dernière consultation le 6 janvier 2022).↩
https://www.evokative.xyz/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Basé dans la région de Québec, Antitube se définit « comme un diffuseur de cinéma d’animation, de cinéma expérimental ainsi que de cinéma d’auteur, fictionnel ou documentaire », avec au cœur de sa mission la diffusion d’œuvres indépendantes, québécoises et canadiennes, https://www.antitube.ca/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Cinépix est un producteur et distributeur indépendant basé à Montréal, https://www.cinepix.ca/ (dernière consultation le 28 janvier 2022).↩
Cette section, inaugurée en 2014, faisait à l’origine honneur à l’histoire des films de genre québécois pour ensuite s’élargir à d’autres patrimoines nationaux et se constitue comme une « vitrine privilégiée à des films rares que l’histoire a négligés, oubliés, voire même snobés ». https://fantasiafestival.com/fr/festival-2021/programmation (dernière consultation le 3 janvier 2022).↩
Les pellicules inversibles produisent une image positive dès le développement de l’élément original exposé dans la caméra. Elles furent largement utilisées par les cinéastes amateurs et expérimentaux, qui projetaient souvent les éléments originaux afin d’éviter les frais associés à la duplication et au tirage de leurs films.↩
La Cinémathèque interdite est une série de programmes doubles à la Cinémathèque québécoise qui s’intéresse à « la grande histoire parallèle du cinéma » et à « l’histoire du cinéma d’exploitation », aux « audaces débridées d’une culture Pop qui ose tout » à partir des archives de la Cinémathèque québécoise, https://www.facebook.com/cinemathequeinterdite/ (consultation le 3 janvier 2022).↩
Dans La Presse (27 octobre 1994, D4), on mentionne les « Vendredis psychotroniques » et les « Nuits psychotroniques », des événements qui présentent des « films et téléséries de seconde zone », https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2178724 (dernière consultation le 3 janvier 2022).↩
En activité depuis 1913, le Bureau de censure des vues animées de la province de Québec devient en 1967 le Bureau de surveillance du cinéma. Les films ne sont plus censurés, mais classés. Pour un bref aperçu historique, voir https://www.rcq.gouv.qc.ca/communiques.asp?id=138 (dernière consultation le 26 janvier 2022).↩
Mediafilm se définit comme « le premier fournisseur de contenu cinématographique en français en Amérique du Nord ». En 1968, l’organisme a mis au point une « échelle d’appréciation » ou de « de cotes artistique » en sept paliers, « reproduite dans l’ensemble des télé-horaires diffusés dans les médias écrits de la province, ainsi que sur plusieurs sites Internet », https://mediafilm.ca/fr/mediafilm-c-est-quoi (dernière consultation le 3 janvier 2022).↩
En effet, Bonneville était un Père membre des Clercs Saint-Viateur. Fondée en 1955 par le Père Jean-Marie Poitevin, prêtre de la Société des Missions étrangères, la revue Séquences a été éditée pendant 40 ans par Bonneville, sous la tutelle de la Commission des ciné-clubs du Centre catholique du cinéma de Montréal.↩
L’Office des communications sociales est fondé en 1966, dans la foulée des activités du Centre catholique national de cinéma, de la radio et de la télévision.↩
Au sujet de la prééminence catholique dans l’appréciation du cinéma au Québec, voir Martin Picard, « Mediafilm : un exemple de laïcisation des pratiques cinématographiques au Québec », Nouvelles Vues no 4 (automne 2005), https://nouvellesvues.org/wp-content/uploads/2021/07/picard.pdf (dernière consultation le 3 janvier 2022).↩
Le premier long métrage d’Alain Resnais avait été amputé de plusieurs minutes par la censure québécoise avant sa sortie en salle dans la province à l’automne 1960. Yves Lever, « Hiroshima mon amour », dans Dictionnaire de la censure au Québec : littérature et cinéma, sous la direction de Pierre Hébert, Yves Lever et Kenneth Landry (Montréal : Fides, 2006), 311–314.↩
Nanarland se dit « le premier site Web dédié aux nanars », https://www.nanarland.com/ (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Douteux.org est une OSBL qui propose une remise en question des produits culturels et des contenus médiatiques, https://douteux.org/douteux-org (dernière consultation le 4 janvier 2022).↩
Shudder est une plateforme de visionnage spécialisée dans le cinéma d’horreur, les thrillers, le cinéma fantastique et de science-fiction, https://www.shudder.com/ (consultation le 4 janvier 2022).↩
Sacha Lebel, Aller aux vues qu’ossa donne ? Pour une histoire culturelle du cinéma populaire québécois (1965–1975), thèse de doctorat (Montréal : Université de Montréal, 2019).↩
Kickstarter est un site internet qui donne la possibilité à qui le propose de financer des projets encore à l’état d’ébauche, permettant ainsi de faire l’économie des coûts inhérents aux modes traditionnels de production. https://www.kickstarter.com/?lang=fr (dernière consultation le 26 janvier 2022).↩
Le film est en accès libre, disponible sur la plateforme Viméo : https://vimeo.com/108360289 (dernière consultation le 26 janvier 2022).↩
