Éric Falardeau et Dominique Pelletier
Avertissement : Ce texte traite de pornographie et contient des termes, expressions et figures de style qui pourraient choquer ou offenser certaines personnes.
L’identité québécoise pornographique est bien en vue dans la culture cinématographique populaire de la province. La parfaite démonstration de ce fait se trouve dans une scène d’anthologie de Jésus de Montréal (Denys Arcand, 1989). Le personnage de Martin, un acteur de théâtre interprété par Rémy Girard, boucle ses fins de mois en doublant des films pornographiques, accompagné de deux actrices. Lors de l’une de ces séances, un quatrième personnage entre en scène dans la bande vidéo, ce qui mène le réalisateur à demander à Martin de doubler dans la même prise les deux rôles masculins. La scène se veut comique : on y oppose des comédiens sérieux à une production jugée bas de gamme. Elle débute avec les voix féminines, qui commentent la diction de leurs collègues interprètes de doublage. L’extrait est doublé dans un registre que l’on reconnaît comme le « français international », avec tous les artifices qui l’accompagnent, et fait se succéder les « copain », « prends ça », « dis-le que tu aimes ça » et l’inévitable « salope ». N’y ont certainement pas leur place les « chum », « quin toé » et « t’aimes ça, ma cochonne » ; c’est du sérieux, leur affaire. « Salope », on se l’accorde, est l’une des rares occurrences d’un français pornographique véritablement international. Martin poursuit, fait de son mieux, change sa voix, alterne rapidement entre deux micros, le souffle court, jusqu’à confondre les personnages. Le réalisateur n’en fait pas de cas, félicite plutôt ses comédiens et leur rappelle que « ce n’est pas grave, personne ne fait la différence ». On n’a pas besoin d’être versé dans la langue pour comprendre qu’il a tort. C’est en effet l’enjeu linguistique de la pornographie qui la situe comme objet dans la culture populaire. En porno, comme ailleurs, il y a de mauvais jeux, de mauvaises langues et de mauvais jeux de langues. La pornographie québécoise serait-elle de l’ordre du mauvais genre ?
À la croisée interdisciplinaire des études pornographiques1 et des études langagières, notamment la traductologie, la linguistique et l’analyse critique du discours2, cet article propose de situer le genre pornographique québécois par rapport à son contexte sociohistorique d’émergence. Avec une approche historique et sociolinguistique, en considérant toujours le film comme un texte dont on ne peut pas séparer les éléments3, cette étude de cas documentera l’émergence de la pornographie québécoise en prenant comme point de départ le doublage au Québec de films pornographiques distribués avant ou en synchronie avec les premiers longs métrages québécois sous licence. En d’autres termes, en traçant l’histoire de la pornographie cinématographique au Québec depuis son émergence, cet article tâchera de répondre aux questions suivantes : les textes des longs métrages doublés en québécois contribuent-ils à la distinction d’une culture et d’une identité pornographiques québécoises ? De quelle manière la pornographie s’inscrit-elle dans la tradition plus large du cinéma québécois ?
Afin de répondre à ces questions, nous comparerons les premiers longs métrages pornographiques locaux, dont Putain de chômage (Daniel Ménard, 1993), Les pipeuses de l’entrepôt (Ron King, 1994) et Montréal est une ville ouverte (Mr. White, 1996), aux textes de films en langue française ou doublés ayant été distribués localement dans les clubs vidéos avec l’autorisation de la Régie du cinéma du Québec (RCQ), ainsi qu’à certaines versions en langue originale. Cette étude de cas marque la première étape d’une recherche plus large sur l’histoire de la pornographie au Québec incluant le cinéma, la littérature, les magazines, le Web, la musique et le spectacle, une recherche qui paraîtra bientôt sous forme de monographie.
Une brève histoire du genre pornographique au Québec
L’émergence du genre pornographique québécois est un sujet peu documenté. Avant la sortie des premiers long métrages locaux sous licence au début des années 1990, la majorité des films pour adultes distribués en français avec l’accord de la RCQ4 étaient des productions étrangères, doublées en grande partie ailleurs que dans la province. Selon les données de la RCQ, 70 longs métrages étrangers distribués en vidéo ont été doublés en français entre 1980 et 1995, parmi lesquels 27 films dont la version originale est en italien, 24, en anglais et 19, en allemand. Quant à la production québécoise, seulement 20 longs métrages sont apparus sur les étalages des clubs vidéos entre 1993 et 1995.
Il est impossible, pour l’instant, de dater avec précision l’arrivée des tout premiers longs métrages pornographiques québécois. Il est évident que des films pornographiques ont été tournés au Québec dans les années 1960 et 1970, un fait corroboré par l’existence de certaines copies de loops5 réparties dans des collections privées6 ainsi que par des témoignages que nous avons recueillis. Une recension des petites annonces publiées dans des magazines et revues pour adultes, dont plusieurs étaient destinées à la communauté libertine ou échangiste, prouve également l’existence de vidéocassettes filmées par des amateurs, qui se les échangeaient entre particuliers. Les encarts à la fin de publications telles que Érosphères, Sextra, Super Sexe et L’Interdit confirment qu’un marché parallèle underground se chargeait de la distribution par la poste de productions amateurs et professionnelles sur support vhs. Toutefois, l’illégalité du genre et la censure institutionnelle imposaient de facto une non documentation de cette production et, le cas échéant, une circulation en dehors des circuits traditionnels rendant l’archéologie de ces médias difficile.

Dès les années 1960, les salles d’art et d’essai repoussent les limites de la permissivité entourant la diffusion et la représentation de la sexualité. Ce n’est qu’à la fin de cette décennie que le cinéma érotique s’impose après le succès populaire de plusieurs films étrangers et celui, définitivement local, de l’incontournable Valérie (Denis Héroux, 1969). Ce genre cinématographique est une bouée de sauvetage pour les salles mono-écran, que les spectateurs délaissent progressivement pour la télévision. Toutefois, si les salles d’art et d’essai décloisonnent la sexualité et profitent d’un certain degré d’indulgence de la part des autorités, le cinéma proprement pornographique, lui, n’est toujours pas autorisé7 ni accepté dans les ménages comme dans la société.
Ce n’est qu’au début des années 1980 que l’on assiste aux premières tentatives pour inaugurer des cinémas consacrés au contenu pour adultes, ce qui place la diffusion du cinéma pornographique au Québec en synchronie avec celle de plusieurs pays occidentaux ayant entamé progressivement l’ouverture de cette tribune dans les années 1970. Par exemple, « Roland Smith, l’infatigable promoteur des cinémas de répertoire, tente d’accélérer l’acceptation sociale du film XXX, ou hardcore. Le 10 février 1982, il ouvre le Cinéma X dans La Scala, salle qui vient de fermer sur la rue Papineau à Montréal8. » L’aventure est de courte durée et la salle ferme ses portes en juillet de la même année, car le public n’est pas au rendez-vous. Le gouvernement est toujours réticent à lever les interdictions9 et les réactions négatives de plusieurs groupes militants limitent les possibilités d’un espace de diffusion voué à ce genre de cinéma10. Comme le résume l’historien Yves Lever dans son histoire de la censure cinématographique au Québec, la pornographie demeure un cas singulier :
Si des productions internationales audacieuses comme Le dernier tango à Paris ([Bernardo] Bertolucci[, 1972]) suscitent nombre de controverses en Europe, la censure québécoise se contente de le réserver aux adultes en 1973. La seule limite qui demeure, à la fin de cette période, est la pornographie dite hard. Si la nudité ne pose plus de problèmes, les gestes amoureux pullulent, mais simulés, les gros plans sur les sexes, l’érection et la pénétration restent encore interdits. […] Au début des années 1980, les formes traditionnelles de la censure sont presque complètement disparues. Il reste quelques restrictions envers la pornographie, mais presque tout le cinéma du monde est accessible aux adultes. […] Dans le Canada, le Québec est devenu, et de loin, la province la plus libérale […]11.
L’arrivée du support vidéo complexifie les choses et transforme les modes de diffusion, de consommation, de légitimation et de réglementation du cinéma. La pornographie ne fait pas exception, comme l’explique Pierre Pageau :
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l’arrivée progressive de la vidéo et de la vidéocassette correspond à la fin des salles érotiques. Ces films d’art et d’essai et ces films érotiques présentés dans des salles spécialisées se sont heurtés à la collectivité et au consensus social. Ils remettent en cause les critères de moralité qui régissaient le cinéma depuis le début du siècle. Si le soft porno établit une nouvelle liberté de représentation de la sexualité dans le cinéma local, on est cependant encore loin de la pornographie. Il faut attendre une dizaine d’années avant que ne soient permis les gros plans sur les vagins et les pénis en érection, sur les pénétrations et la masturbation. Et cela se produit à travers les copies vidéo des films, qui bénéficient d’un vide juridique pendant les années 1980 et dont la loi n’oblige la classification, à l’égal de tous les autres formats, qu’en 199112.
Le flou juridique auquel réfère Pageau réside dans le fait qu’avant 1991, nul n’était tenu de soumettre un film destiné aux clubs vidéos pour approbation à la RCQ. Par conséquent, entre la mise en place de la Régie en 198313 et l’obligation pour chaque production d’en obtenir un visa14, plusieurs longs métrages ont été distribués sur le territoire sans laisser de traces. Toujours selon Yves Lever, « […] depuis 1992, un règlement impose de placer le matériel vidéo “18 ans et plus” et caractérisé de “sexualité explicite” dans un espace distinct et séparé par des divisions, où est bien indiquée la mention “ADULTES”15 ». Entretemps, comme partout en Amérique du Nord, « on assiste rapidement, dans tout le Québec, à la fermeture de dizaines de salles, car le nouveau support vient bouleverser la donne du produit pornographique qui, du grand écran, passe au petit dans l’intimité des foyers, là où aucune loi ne lui impose de restrictions16 ». Comme le rapport à la pornographie n’est pas le même en salle que dans l’intimité de son domicile, le fait de retirer le visionnement public de l’équation a une influence sur la langue employée dans les films. Les réalisateurs et les producteurs n’ont plus à se soucier de la réception collective d’une œuvre et des commentaires que celle-ci génère sur la place publique. La pornographie parle désormais directement au spectateur, en toute intimité, seule à seul.
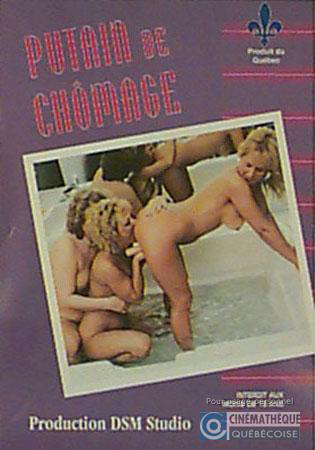
Émergence de la pornographie québécoise originale
C’est en 1994 que la RCQ accorde une licence à sept longs métrages québécois, dont Putain de chômage, considéré officieusement comme le premier film québécois du genre. Dès l’année suivante, des productions originales locales apparaissent sur le marché aux côtés des sorties étrangères. Si l’industrie internationale est en pleine effervescence, l’industrie québécoise, elle, tire de l’aile : elle émerge difficilement de l’illégalité et demeure enlisée dans ses traditions, tant du point de vue du contenant que du contenu. Le tabou entourant la porno devient culturel, à la vue de tous, incluant son esthétique amateur indissociable de ses moyens limités. De plus, l’étroitesse du milieu place ses interprètes, ses producteurs et ses techniciens à risque, car il est très difficile pour eux de conserver l’anonymat. Dans un dossier spécial de la revue Québec érotique paru en 1994, le journaliste Pierre Gervais décrit la situation :
Peu de films sont produits au Québec. Seulement sept sont sur le marché légal québécois. Selon [Stan, le propriétaire du club vidéo Sexe-O-Choix], ils sont de mauvaise qualité, n’offrent que peu d’action aux clients qui sont habitués à beaucoup plus. Les histoires prennent trop de place, les explications sont trop longues. Ils ennuient les clients en mal d’action. Toutefois, cette réputation risque de changer avec l’avènement de la compagnie Black Lava Productions, qui offrira sous peu des films tournés au Québec, avec des acteurs québécois : des films de bonne qualité. Le premier est d’ailleurs sur les tablettes depuis le 29 août dernier. Il se nomme Sex Fan Club [(Ron King, 1994)]. Il lui reste maintenant à se tailler une place parmi les 180 nouveaux films légaux qui arrivent sur le marché du vidéo pornographique chaque mois17.
L’année suivante, une douzaine de films québécois pour adultes obtiennent une licence de distribution de la RCQ. Les premiers producteurs-cinéastes font leur apparition, notamment Shawn Ricks, Robert Moreau, Marc Hendrix et quelques autres. Les films pornographiques locaux, nous l’avons vu, étaient auparavant disponibles par l’entremise de réseaux de distribution parallèles (petites annonces, magazines échangistes, etc.) à l’abri des regards, donc difficiles, sinon impossibles à retracer. C’est d’ailleurs le cas des premières productions du cinéaste Marc Hendrix, qui œuvrait déjà dans le genre pendant les années 1980. Selon un autre article de la revue Québec érotique, ce dernier
[…] est dans le milieu du film pour adultes depuis une douzaine d’années [en 1997]. Il a tourné son premier film, L’initiation de Mélanie, en 1993, ont suivi Mémoires intimes [(1995)], Les filles de Fantasex [(1996)], et sa suite, Les filles de Fantasex 2 [(1997)], qui vient de paraître, sous l’étiquette Valentine Vidéo, l’étiquette XXX des distributions ShowTime. En 1992, lorsque la Régie du cinéma a donné son aval à la production de films pornographiques, le premier film d’Hendrix a été le deuxième approuvé par la régie. Une nouvelle industrie venait de naître18.
L’industrie québécoise des films pornographiques voit « officiellement » le jour dans les années 1990, au moment de sa légalisation par les organes gouvernementaux régissant la diffusion et la distribution de ces objets19. Depuis cette légalisation, la pornographie québécoise a pris deux tangentes : d’une part, la prise d’assaut du marché international par l’entremise du Web avec des acteurs qui deviendront les futurs géants de la pornographie numérique, comme Gamma et MindGeek ; et, d’autre part, l’intégration de référents culturels et de personnages québécois comme éléments centraux dans le récit des productions d’ici, comme celles produites par Érobec, AD4X et Pégas Productions, pour ne nommer que celles-là. Certaines productions se démarquent par leur ancrage dans l’identité, la politique et la culture québécoises. C’est notamment le cas de Montréal est une ville ouverte, l’une des premières productions ayant fait l’objet de notre analyse, mais également de productions plus récentes, comme celles qui évoquent la crise étudiante de 2012, dont Agente 728 XXX (AD4X, 2012), 3 carrés rouges (AD4X, 2013) et Montre-moi ton carré rouge (AD4X, 2013), ainsi que celles qui mettent de l’avant des figures bien connues des Québécois comme le Bonhomme Carnaval, rebaptisé Bonhomme Carnanal dans la production Bonhomme Carnanal : la recherche des duchesses (AD4X, 2015).
Le doublage au Québec
L’histoire du doublage au Québec est indissociable du contexte d’insécurité linguistique ayant mené à l’adoption de mesures législatives visant à protéger le fait français en Amérique du Nord20. Certaines études détaillent l’arrivée de versions doublées dès les années 194021. Rappelons toutefois que de nombreuses tentatives pour imposer une traduction (par sous-titrage ou par doublage) ont été faites dans les années 1960 et 1970. Selon Lacasse, Sabino et Scheppler, en 1982,
en réaction à l’augmentation des films en version originale anglaise dans les salles québécoises le gouvernement du Québec élabora un nouveau projet de loi. Cette loi ne fut finalement adoptée que trois ans plus tard. La loi 109 (phonétiquement « sang neuf ») forçait les majors américains à fournir une version en français dans les 60 jours suivant la sortie de la version originale anglaise dans les salles du Québec22.
Outre ces considérations historiques, la traduction et le doublage – avec ses particularités sonores (accent, prononciation, syntaxe, hauteur de la voix, etc.) – soulèvent de nombreuses questions théoriques. Dans un article sur le doublage au Québec, la traductologue Luise von Flotow souligne que les discours entourant cette pratique depuis les années 1960 sont de trois ordres : culturel, économique et pédagogique. Par conséquent, et c’est ce qui nous intéresse dans ce qui caractérise l’émergence de la production pornographique québécoise, « questions about the quality and type of language used for dubbing in Québec are pressing and recurrent. They pertain in many other societies that dub Hollywood film and raise sensitive issues related to aesthetic and culture, the control of language and identity23. » Sachant que la pornographie est d’abord et avant tout une production culturelle spécifique dont la résonnance est indissociable de son environnement24, comment peut-on, dans ce contexte, tracer son imaginaire proprement québécois avant la première vague locale de films pour adultes ? La traduction a‑t-elle servi de tremplin à la production locale ? De quelles façons les productions doublées font-elles état des spécificités culturelles et sociolinguistiques québécoises ?
Le doublage pornographique interlinguistique (entre deux langues) a de particulier qu’il émerge d’une longue tradition de doublage intralinguistique (dans la même langue). Dans un dossier sur la traduction érotique et pornographique que nous avons codirigé pour Circuit, le magazine de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec, nous mentionnons que
[d]ans les années 1960, 1970 et 1980, bon nombre de cinéastes pornographiques enregistraient leurs scènes de sexe en plan muet et ajoutaient le son à l’étape de la postproduction. En plus d’échapper à certaines contraintes techniques et budgétaires, ils pouvaient ainsi filmer des scènes entières sans coupures inutiles, en employant plusieurs caméras ou en effectuant le montage à l’intérieur même du plan (nombreux recadrages, caméra à l’épaule, zoom avant / zoom arrière). Cette méthode permettait également de mettre facilement l’accent sur les voix ou la musique et de raffiner les effets du montage, notamment ceux des gros plans, dans le produit final. […] En raison de la pratique qui consiste à doubler systématiquement les films pornographiques peu importe la langue dans laquelle ils sont tournés, la traduction intralinguistique occupe une place importante dans cette industrie. Mais l’arrivée des caméscopes semi-professionnels au début des années 1980 change la donne. Il est désormais possible d’enregistrer le son à même la bande, et ce, pour de plus longues périodes qu’avant. La technologie n’a cependant pas tout à fait mis fin à l’enregistrement sans son, toujours en usage dans certaines productions25.
Le cinéma québécois a sa propre tradition de postproduction sonore. Beaucoup de cinéastes pornographiques québécois enregistraient le son directement avec la caméra vidéo, mais y ajoutaient une musique d’accompagnement. Ils allaient parfois jusqu’à omettre complètement la prise de son de la scène, à l’image des productions étrangères en vogue à l’époque, comme Babes Angels, tourné dans l’ancien manoir des Lavigueur (Stéphane Chouinard, 1997). Nous ajoutons ainsi, dans le dossier précédemment mentionné, que
[s]i le cinéma vise à accrocher la spectatrice par la paupière, le doublage cherche à l’attraper par l’oreille. En matière de pornographie, l’esthétique de l’image n’est pas tout ; le son et le langage ont une part importante à jouer dans le résultat final. En conséquence, pour exciter davantage le public, on amende la trame sonore. On ne traduit ainsi pas seulement des mots, mais des voix, des sons, une ambiance. Les sons du sexe doivent séduire : les dialogues sont traduits soit pour laisser libre cours à l’imagination, soit pour donner une impression de réalisme, selon le courant cinématographique dont se réclame la cinéaste. Mais peu importe la tradition, la visée reste la même : améliorer la qualité de l’original26.
En effet, l’œuvre pornographique est souvent le résultat de plusieurs démarches de traduction : certaines intralinguistiques, comme le sous-titrage codé, qui gagne en popularité depuis les dernières années, et certaines interlinguistiques, comme le doublage ou le sous-titrage dans une autre langue. Certaines sont d’ordre intersémiotique, comme les choix esthétiques suivant les modes de production ou la médiation culturelle de certains discours pornographiques devant permettre de rejoindre davantage le public par l’ajout de référents. Nous poursuivons finalement en précisant que
[l]es types de doublage interlinguistique varient selon le genre de pornographie, la maison de production, la région et parfois même les actrices choisies par [le ou] la cinéaste. Certains doublages s’éloignent des dialogues d’origine, d’autres transforment la voix des personnages ou inscrivent ceux-ci dans un contexte géographique ou social différent de l’original. Dans les productions doublées au Québec, comme À la recherche de chattes canadiennes (In Search of Canadian Beaver, Shawn Ricks, 1994), on tente en général de limiter la variation linguistique et les accents, de même que les expressions et termes québécois au profit d’un français artificiellement international, bien que plusieurs actrices [et acteurs] conservent, par choix ou [non], leur accent, leurs locutions et leur lexique27.
Depuis la popularisation du cinéma érotique avec, entre autres, la série Bleu Nuit, diffusée à la chaîne télé TQS de 1986 à 2007, « [l]e doublage a donné un cachet particulier à ces œuvres aux titres et répliques désopilantes, gracieuseté de traductions inventives28 ».
Particularités du cinéma pornographique traduit au Québec
La présente analyse porte sur les particularités culturelles du texte de cinéma pornographique québécois, tant celui issu du doublage que celui provenant de versions originales. Elle s’attache à trois éléments – la trame narrative, les expressions idiomatiques et les pornèmes – relevant chacun d’enjeux de traduction particuliers. La traduction du genre pornographique en un genre filmique proprement québécois témoigne d’une médiation culturelle sans précédent. Dans notre analyse des trames narratives, nous comparons les référents culturels des traductions des productions étrangères à ceux des films pornographiques québécois émergents. En faisant l’analyse complémentaire des expressions idiomatiques présentes dans les films de notre corpus, nous avons situé la langue des dialogues par rapport au français québécois et à ses variations de lexique et de registre. De plus, notre analyse des pornèmes, un concept suggéré par Roland Barthes et approfondi par la linguiste Marie-Anne Paveau, met en lumière les mots et interjections reflétant l’identité culturelle pornographique québécoise projetée à l’écran29. Paveau mentionne, dans son livre sur le discours pornographique, que le lexique de la pornographie s’articule à l’abri des regards pour les gens qui ne sont pas en contact direct avec le milieu. Le vocabulaire de ce champ d’activité présente des signifiés qui relèvent exclusivement de ce domaine ; il constitue une langue de spécialité avec sa terminologie propre. En s’appuyant sur le modèle conceptuel issu de la linguistique du sème et du lexème, respectivement les plus petites unités de sens et du lexique, Paveau reprend cette notion de pornème pour désigner les termes issus du lexique pornographique. Le pornème représente la plus petite unité du discours pornographique ; c’est un mot du domaine spécialisé de la pornographie, élaboré par la pornographie et ses propres milieux30.
Certaines études dans le champ de l’analyse filmique se sont intéressées au doublage – l’image étant généralement au cœur de ces recherches –, mais rares sont celles qui portent directement un regard sur l’objet pornographique. Parmi celles-ci, notons celle de François Perea, qui propose de catégoriser les mises en scène et affects provoqués par les dialogues sur les sites internet dédiés aux contenus pour adultes (les tubes). Il identifie quatre formes verbales et vocales, soit :
- des formes difficilement circonscriptibles, parfois confondues, tels les souffles sonores, râles, gémissements, cris (ne correspondant pas à des éléments du lexique) très largement majoritaires (elles représentent de manière variable selon les extraits entre 70 % et 100 % des productions de notre corpus), à la présence et à l’intensité croissantes, se résorbant après le climax articulé à l’éjaculation masculine la plupart du temps ;
- plus rarement (entre 5 % et 18 % de notre corpus), des formes lexicales que l’on qualifie de manière très générale d’interjectives (« oui », « oh oui », « yeah ») et des jurons (« putain ») ;
- plus rarement encore, des formes incitatives (moins de 5 % de notre corpus) : « Vas‑y » (seul ou en position initiale des formes suivantes), « mets-moi ta queue là », « viens », « avale tout », « crache », « oui » ;
- et / ou des commentaires du ressenti (moins de 5 % de notre corpus) censé être celui du locuteur ou de son / sa partenaire : « Ouais, je vais jouir là », « j’ai envie de la sentir », « tu aimes ça ma cochonne », « ça te plaît de voir ça31 ».
Selon Perea, les formes vocales ou verbales sont donc soit indiscernables, interjectives, incitatives ou affectives, mais on constate que la fonction principale du discours est phatique. Il sert à agrémenter la connexion entre les partenaires et à donner l’impression d’une communication fluide, alors que peu d’importance est accordée au sens des énoncés. Pourtant, dans le cas du cinéma pornographique québécois, la signification culturelle des énoncés et des signes est précisément ce qui permet au public de le comprendre en s’y identifiant. Les indiscernables doivent avoir une sonorité familière, les interjections ne doivent pas jurer avec ce qui reste acceptable à entendre, les incitatives doivent être motivantes et les affectives doivent être crédibles. Le récit, les expressions et les pornèmes doivent se présenter aux Québécois comme étant les leurs. Cependant, en écoutant les productions et en en comparant les similitudes et les variations, on constate que la québécitude demeure dans la pornographie hautement influencée par la subjectivité de ses tabous linguistiques, sexuels et esthétiques :
Parmi les nombreuses questions à l’étude : quelles sont les raisons pour lesquelles certains pornèmes spécifiques à une région, comme les mots québécois « fourrer » et « graine », leurs quasi-synonymes plus répandus « baiser » et « queue » ou leurs contreparties plus fréquentes de l’autre côté de l’Atlantique « niquer » et « bite », sont tous des constituants du discours pornographique du Québec ? Faut-il en conclure qu’au-delà de l’influence de la pornographie étrangère, les choix éditoriaux des productrices, réalisatrices et traductrices d’ici ne se font pas en fonction de la région ? Doit-on poser que le rôle de ces dernières est de choisir des pornèmes qui vont exciter leur public, peu importe la provenance de ces mots ? Au-delà des réponses auxquelles ces recherches mèneront, un des résultats espérés est d’amener les Québécoises à reconnaître leur pornographie comme production culturelle, afin qu’elles soient mieux en mesure de la produire, de la traduire et de la diffuser selon leurs besoins et leurs sensibilités32.
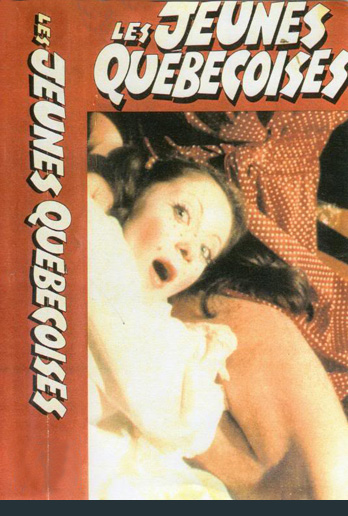
Un cas d’exception
Tourné au Québec, Les jeunes Québécoises (The Young Quebecers, Claudio Castravelli, 1980) est un cas de doublage unique en son genre. Comme peu de films semblables doublés en québécois, le long métrage contient un grand nombre d’expressions vernaculaires spécifiques à nos régions. Le registre de langue est familier, ce qui confère au film une certaine fluidité. Les répliques donnent en effet l’impression de dialogues qui pourraient avoir lieu dans la réalité, malgré quelques expressions interrogatives dans un français très normatif, comme « Va-t-il…? » à la place de « Il va-tu…? » Le film contient aussi de nombreuses expressions familières, comme « envoye », « pogner », « guidoune », « mener du bruit », de même que des jurons comme « hostie » et « tabarnac ». D’un point de vue culturel, sa phraséologie pornographique est particulièrement riche. Des phrases telles que « Y’était bandé comme un maudit », pour commenter une érection ; « Ça y allait par-là », pour commenter l’action ; « J’ai pogné la picouille du groupe ! », pour témoigner du dépit de l’un des acteurs d’avoir pigé le godemichet le plus petit lors d’un tirage à la courte paille ; « J’aimerais ça te manger le casque », prononcé [kas], pour manifester l’intérêt de faire une fellation ; et « Mange-moi le bat », pour inciter à la fellation, dénotent des traductions bien ancrées dans la culture québécoise. Celles-ci produiraient difficilement le même effet chez un public d’ailleurs, qui se verrait dépaysé devant la syntaxe et le lexique utilisés33. Les pornèmes purement québécois du film font presque tous référence au phallus, comme « casque » ou « batte » (qui renvoie à la batte de baseball), et leurs occurrences sont très peu nombreuses. Ceci confirme la tendance qu’ont généralement les doubleurs au Québec de le faire dans un français général, voire international : la phraséologie et le lexique employés sont très proches de la langue générale, avec très peu de termes spécifiques à la pornographie. Les pornographies doublées au Québec peuvent ainsi aspirer à être attrayantes pour une diversité de francophonies et diffusées à l’échelle internationale.
En raison de divers incitatifs, dont certains de nature fiscale, le film s’inscrit dans une série de longs métrages tournés en anglais au Québec dans les années 1970 et 1980 par des réalisateurs étrangers. Quelques-uns de ces réalisateurs mettent l’accent sur le caractère pittoresque du Québec, sa francophonie, ses paysages naturels et urbains, ses référents culturels exotisants et vendeurs. De ce fait, durant cette période, une partie de la production pornographique originale québécoise ne s’adresse pas directement à un public québécois, mais plutôt à un public étranger, attiré par le romantisme européanisé de notre terroir. En plus de Les jeunes Québécoises, c’est le cas de Sex and the Office Girl (Ron Clark, 1972) et des premiers longs métrages pornographiques gais d’ici tels que French Erection : Au Maximum (William Dufault, 1992) et Call of the Wild (Kristen Bjorn, 1992).
Mis à part les films que nous venons de mentionner, le film Scandale (George Mihalka, 1982) se démarque du lot. Cette comédie érotique à la limite de la pornographie, dans laquelle des fonctionnaires décident de tourner un film osé à même les fonds du gouvernement, présente des scènes que l’on pourrait juger de nature X, bien que le film ne soit pas considéré comme une production pornographique. Il marque la fin du chapitre que l’on qualifie de « Maple Syrup Porn » et met la table pour la légalisation de la pornographie au Québec et l’émergence des premiers longs métrages québécois proprement pornographiques34.
Animée par la langue de chez nous
La tendance des réalisateurs étrangers à mettre de l’avant des marqueurs pittoresques du Québec a permis de décomplexer le doublage pornographique québécois par rapport à sa propre identité culturelle. Ce changement de rapport à l’altérité, où l’objet doublé appartient à sa propre culture, permet aux interprètes de doublage, auxquels on accordait déjà une énorme liberté dans le cadre de leurs performances, d’être plus à l’aise d’employer leur propre vocabulaire vulgaire, notamment pour remanier les référents déjà présents dans le texte original. Dans beaucoup de ces productions, le doublage ne bénéficie que d’une seule prise, où l’improvisation prédomine, ce qui se remarque dans le manque de synchronisme entre les sons, les dialogues et le mouvement des lèvres ainsi que dans l’utilisation abusive de trames sonores musicales pour masquer les défauts de la bande de doublage.

À la recherche de chattes canadiennes (The Search for Canadian Beaver, Shawn Ricks, 1994) est un bon exemple de film où les lèvres bougent, mais où le doublage ne correspond pas, rappelant la scène de Jésus de Montréal mentionnée en introduction. Ce film, à la distribution entièrement féminine sauf pour des rôles secondaires non pornographiques, raconte l’histoire d’enseignantes de l’école américaine des « lèvres rouges », en anglais Lipstik Girls35, envoyées au Canada pour faire une tournée des bars de danseuses. Elles traversent la frontière aux chutes Niagara pour ensuite se retrouver dans un bar de motards, où elles se font arrêter lors d’une descente par la police montée canadienne. L’un des deux policiers, joué par le réalisateur du film, avant de mettre les « Lèvres rouges » derrière les barreaux, s’exclame : « Salope, t’es sur un sol canadien ! » Son collègue, tout aussi contrarié, leur dit qu’elles sont en train de manger tous leurs castors, un référent à l’anatomie féminine très commun en anglais, dont l’équivalent direct en français dépend des régions et des usages. Parmi les locutions québécoises issues de la langue générale, on trouve « la grosse Bertha », les « bobettes », « Allez les filles, vous êtes capables ! », « Lâchez pas ! » et l’expression raciste « plan de nègre ». Côté pornèmes, que des onomatopées inaudibles et asynchrones. La trame narrative est, quant à elle, truffée de référents associés à l’imaginaire canadien : police montée, castors, chutes Niagara, froid hivernal, motards. Dans le doublage, la verbalisation de ces icônes canadiennes est rendue de manière très candide, presque parodique. Ceci renforce notre impression que le caractère québécois d’un doublage ne repose pas nécessairement sur le lexique employé dans sa traduction, qu’il soit général ou pornographique, mais plutôt sur le rendu de ses référents, qui peut jouer tant sur la forme que sur le fond.
La suite du film, À la recherche de chattes canadiennes 2 (The Search for Canadian Beaver 2, Shawn Ricks, 1995), montre les héroïnes partant recruter de nouvelles « Lèvres rouges » pour préparer une autre tournée canadienne des bars de danseuses. Le film commence avec un rappel du premier : « On s’est retrouvées en dedans avec toutes ces bitches qui voulaient nous sauter. » Après quelques scènes d’audition, les nouvelles Lipstik Girls prennent d’assaut la Place Bonaventure pour le show Aphrodite 1994, le précurseur du Salon de l’amour et de la séduction. Après une audition supplémentaire, nous sommes transportés sur la scène du bar de danseuses montréalais Solid Gold pour la première performance des nouvelles Lipstik Girls. Le doublage de ce deuxième film se voit définitivement plus précis et plus réussi que celui de son prédécesseur. Le caractère bon chic bon genre des recruteuses venues de l’étranger est marqué par le fort accent anglophone des actrices de doublage. De leur côté, les actrices doublant les personnages locaux utilisent un lexique très international, ponctué par des expressions occasionnellement vernaculaires, notamment le dédoublement du pronom « tu » dans les phrases interrogatives : « Tu veux-tu que je te mange encore l’orteil ? », « T’es-tu prête pour la première ? », ou encore l’omission du « ne » de négation : « Je sais pas, mais cette conversation commence à m’exciter royalement. » Sur le plan de la trame narrative, les référents canadiens sont beaucoup moins présents et sont remplacés par des lieux iconiques de Montréal. L’élaboration d’une traduction référentielle pour ces éléments narratifs est laissée à l’interprétation du spectateur.
L’appel de la nature (VF de Call of the Wild) nous ramène à ces archétypes canadiens à travers sa représentation de la figure masculine : bûcheron, police montée, campeur, chasseur, travailleur de chantier. À la manière des Village People, musique folklorique et chemises « carreautées » à l’appui, les personnages du film sont représentés sous forme de vignettes faisant de l’identité canadienne l’une des marques de commerce de l’exotisme cosmopolite gai. À notre avis, le film est un clair incitatif pour le tourisme gai au Canada. Il ajoute à l’attrait des lieux marquants dans l’histoire LGBTQ+ à l’échelle mondiale, comme c’est le cas pour le village gai de Montréal, et de ses structures législatives favorables au respect des droits de la personne et à la liberté d’expression de l’identité homosexuelle.
Comme l’a mentionné Nikola Stepic, le tourisme médiatique est une conséquence considérable des pèlerinages effectués vers les lieux consacrés par les médias. Les lieux de culte homoérotiques mis en lumière dans les pornographies locales ne font pas exception à cette règle36 :
Film-induced tourism is a more recent example of what we historically might call “media tourism”; indeed, theorist Stijn Reijnders has historicized media tourism to include oral folk traditions, which have prompted the so-called “legend trips” to locations associated with ghost stories, as well as nineteenth-century “literary tourism”, organized around the settings of popular Victorian novels, or the homes and graves of famous authors. Transmedia examples from the nineteenth century onward include Baker Street in London, England, for its association with Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes, Prince Edward Island for its association with Lucy Maud Montgomery’s Anne of Green Gables, the so-called Millennium Tour in Stockholm, Sweden, conceived around the literary hit The Girl with the Dragon Tattoo… (And for what it’s worth, I would argue that the Montreal porn canon is only matched by Anne of Green Gables—I’ve been struggling to think of more examples of Canadian film-induced tourism.) To say nothing of cities like New York, where tours based on popular TV shows like Friends or Sex and the City have been popular for years. Reijnders writes that media-induced pilgrimages to urban centers “provide the framework within which many people get to know a new city37”.
En plein développement, la pornographie homosexuelle canadienne cherche à s’identifier au rayonnement de ses lieux et paysages marquants, lesquels sont propices à l’épanouissement de l’identité et de la sexualité gaies. L’imaginaire du terroir canadien comme une contrée sauvage, vierge, incarne souvent l’invitation à explorer la corporalité d’un territoire inconnu ou interdit. Le personnage du film pornographique gai devient ainsi familier et pittoresque à la fois, car il projette un soi sexuel sur un autre culturel. La figure de la police montée, présentée aux côtés de son grand cheval noir, est frappante : on est dans le territoire du tabou – celui de la zoophilie – et très peu d’images suffisent pour nous le rappeler.
Alors que l’on vend le Canada comme l’escapade gaie ultime, le doublage de la bande sonore de L’appel de la nature se répète comme un mantra. Les mêmes échantillons de voix sont juxtaposés différemment dans plusieurs scènes, plus particulièrement au moment de l’éjaculation : « Je viens, hostie ! », « Ah oui, viens, mon cochon ! », ponctués des mêmes gloussements génériques. Les sacres se succèdent sans gêne : « Envoye, mon hostie ! Envoye, tabarnac ! Prends-là ! Hostie que c’est bon ! » Comme les acteurs sont québécois, la langue de tournage du film est le français, la bande sonore des scènes de sexe est doublée dans les deux langues officielles, tandis que les segments de présentation entre les scènes sont en français et sous-titrés en anglais.
On constate que les productions pornographiques canadiennes et québécoises doublées, qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, suivent de façon générale deux trajectoires, et ce, peu importe le nombre de régionalismes assumés. On trouve d’une part les films qui sont tournés ici, doublés pour un public étranger, et, d’autre part, les films tournés ailleurs, doublés pour le marché québécois. Dans le premier cas, les films cherchent à appâter un public étranger en s’appuyant sur l’altérité des identités canadienne et québécoise et leurs diverses représentations sexuelles. Dans le deuxième cas, les films cherchent à atteindre des standards de professionnalisme et de diffusion à l’échelle du marché international, ce qui les mènent à éviter un lexique vernaculaire, cependant trahi par l’accent des acteurs et des actrices, typique de la sociolinguistique du Québec. Le doublage en français international existe alors pour les mêmes raisons qu’existe le doublage truffé de sacres et d’expressions québécoises, car exotiser le personnage devient une autre stratégie employée pour le vendre au public. Comme la porno homosexuelle est principalement exportée, elle est plus assumée dans ses tabous linguistiques, notamment le vernaculaire québécois, que la porno hétérosexuelle, principalement importée et marquée par son caractère étranger, dont on n’arrive toujours pas à justifier l’usage pour un public d’ici. Hustler 17 (VF de Hustler 17, De Santos, 1984), doublé dans un français international avec une diction exagérée, monotone, presqu’infantilisante, en est le parfait exemple. Ce n’est qu’avec l’arrivée des premiers films pornographiques québécois francophones que l’on s’adresse directement aux gens du pays ; c’est enfin à leur tour de se laisser parler d’amour.
Une pornographie d’ici pour les gens d’ici
Bien que le contenu des premiers films pornographiques québécois francophones soit radicalement différent de celui de ses précurseurs étrangers ou anglophones, les méthodes d’analyses restent les mêmes. Sur le plan du langage, les phrases plus typiquement québécoises sont souvent liées aux trames narratives, se réfèrent au contexte sociohistorique et n’appartiennent pas au registre explicite. Les pornèmes utilisés dans ces films relèvent souvent du français international, associé à un professionnalisme jugé exportable, qui permet de légitimer la qualité des productions locales. La principale différence entre la pornographie québécoise francophone et la pornographie doublée au Québec réside dans l’omniprésence de référents culturels liés à l’identité québécoise que présente la première, et ce, dans le récit plutôt que dans le langage.
Putain de chômage raconte la triste histoire de Richard, interprété par Bosco, qui a récemment été mis à pied par son employeur et qui hésite à dévoiler son statut de chômeur à son épouse, interprétée par Dundy Danger, qui vient d’acheter une balayeuse à plein prix à un vendeur porte-à-porte. Ne pouvant pas retourner l’appareil, Richard suggère que sa conjointe se prostitue pour subvenir aux besoins du ménage. Voyant le plaisir succéder à la nécessité, ce dernier commence à regretter amèrement sa proposition. Le futur lui donnera raison, car peu après son épouse mourra tragiquement du sida, ce qui le laissera seul, toujours sur le chômage. Dans les dialogues, plusieurs expressions sortent du lot, mais n’appartiennent pas au registre érotique et renvoient à la situation socioéconomique des personnages, voire à celle des acteurs et actrices. Parmi les exemples, notons « câlisser / crisser dehors » (mettre à pied), « la même hostie d’affaire », « je reste pas icitte », « Quessé que tu veux me dire ? » et le classique « patente ». Au-delà du langage, la trame narrative marque le fait québécois de manière frappante en brodant directement sur la crise économique des années 1980, l’œuvre baignant dans une ambiance post-Révolution tranquille. Les référents catholiques comme le chapelet y côtoient les godemichets, qui sont les personnages principaux d’une pornographie nouvellement légale. Ce passage moral vers le laïc, vers une laïcité pornographique, demeure ancré dans une culpabilité judéo-chrétienne. En témoigne la finale, où la protagoniste est punie pour les déviances de son mari.
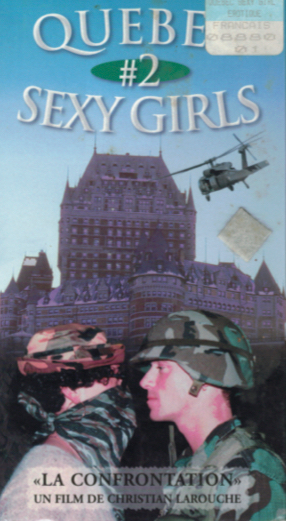
Dans un même ordre d’idées, le film Montréal est une ville ouverte, presque dépourvu de dialogues, est une série de cartes postales pornographiques qui ne lésinent pas sur l’iconographie religieuse. S’y côtoient le Diable, des bonnes sœurs, l’Oratoire Saint-Joseph et, bien entendu, la Sainte-Flanelle, mise en vedette dans la scène d’ouverture, qui se déroule sur une patinoire de hockey avec un gardien de but rappelant Patrick Roy. Le voyage se poursuit avec Québec Sexy Girls 2 : la confrontation (Christian Larouche, 1995), un gonzo qui raconte la suite des périples autour de la Belle Province de Big Ben et Butt Luke. Après avoir quitté Québec, le dynamique duo mentionne le risque de se faire donner une contravention pour excès de vitesse à la vue d’une auto-patrouille de la Sûreté du Québec et se voit plongé dans une série de flashbacks de la crise d’Oka mêlant caricatures originales et images d’archives. S’ensuit une scène de sexe soft évoquant le face à face entre Lasagne, ici interprété par une femme racisée aux cheveux bouclés, et l’ex-caporal Patrick Cloutier, en chair et en os38. La scène suivante se déroule dans la cuisine d’un restaurant, puis dans un hélicoptère. Ensuite, Big Ben et Butt Luke s’arrêtent à une halte routière, où Ben surprend un couple tatoué et arborant la coupe Longueuil en train de forniquer dans les toilettes. En bon pornographe, Ben demande à Luke de sortir sa caméra pour les filmer : « Envoye, Butt Luke, elle est allumée, ta caméra, viens‑t’en. » Le film se termine sur une scène flashback de deux lesbiennes dans un club vidéo érotique. Encore une fois ici, le film est un récit de voyage autour du Québec, à la différence qu’il s’adresse aux gens d’ici, les seuls capables de comprendre l’accent, les référents et les renvois à l’actualité. Volontairement ou non, ce film s’inscrit dans les courants contemporains de la cinématographie québécoise, fortement marqués par la politique et les questions identitaires.
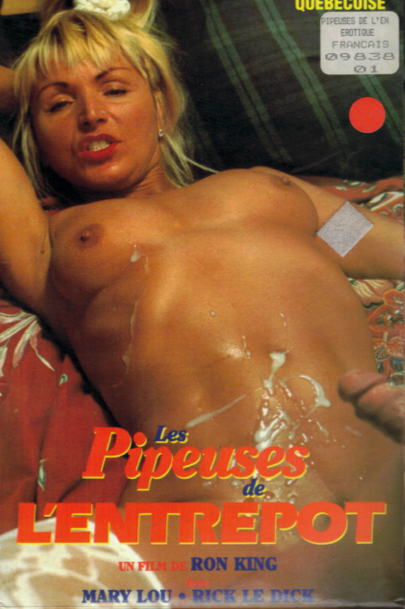
Une question d’oralité
Des films comme La pêche aux sirènes (Ron King, 1993), Sex Fan Club et Les pipeuses de l’entrepôt représentent un autre courant de la pornographie de cette époque, dont Les pipeuses de l’entrepôt est le plus parfait exemple. Après une série de bandes-annonces en anglais présentes sur plusieurs des vidéocassettes de l’étiquette Black Lava, le film commence lorsque Rick Ledyk propose à l’une de ses collègues de lui faire visiter l’entrepôt, sous l’œil vigilant de la réceptionniste anglophone. Après une partie de jambes en l’air entre employés, on passe à une soirée échangiste entre amis autour d’un traditionnel souper spaghetti. La structure de ce scénario ressemble beaucoup à celle de certains films étrangers et ne s’adresse pas du tout au fait français d’Amérique du Nord. Le lexique employé est très international, incluant les expressions pornographiques : « J’adore ça ! », « Mange-moi les seins », « Fais-moi venir », « Oh oui, c’est bon ! » On sent dans le jeu des acteurs et des actrices que le vernaculaire est réprimé, ce qui rend leurs dialogues improvisés parfois maladroits : « Vous avez bien de beaux vêtements, les femmes ! » L’oralité est au premier plan dans l’expression narrative et culturelle du film. Comme mentionné précédemment, le vernaculaire est à proscrire ici ; on privilégie plutôt l’exotisation des dictions, notamment au moyen de l’emploi d’un accent anglophone. Les dialogues sont ponctués de tournures interrogatives : « On va faire l’amour ? / On va baiser », « Ce sera pas long que tu vas venir, hein ? », « Je t’excite plus que ta femme ? » L’expression de l’affirmative, dans le film, témoigne d’une réalité tout à fait contraire.
À ses heures, l’une des actrices devient narratrice du film. Elle se laisse emporter par ses ébats, clairement perlocutoires, qui marquent une jouissance artificielle indubitable :
Ah, je jouis fort. C’est tellement chaud que ça me jouit [sic]. Tu chatouilles mon clito. Je veux venir en même temps que toi. Je suis toute à l’envers avec toi, j’ai des frissons. […] Je viens pour toi. Je me sens cochonne. J’en veux, du cul. J’en veux, donne-moi en comme il faut. Va loin, donne-moi en de ton sexe, des bons coups, comme faut, vas‑y, t’es capable. Je la sens, ma chatte. Je vais rendre des jaloux [sic]. T’es mouillé. Mouille-moi, mouille-là ma chatte39.
Dans Excitable Speech (1997), Judith Butler utilise la typologie locutoire d’Austin pour distinguer l’acte linguistique efficace, illocutoire, où ce qui est dit est en synchronie avec une action, de l’acte linguistique performatif inefficace, perlocutoire, dont les conséquences ne suivent pas immédiatement l’acte linguistique en question. Dans sa manière de performer la pornographie, l’actrice mentionne tellement qu’elle jouit qu’il devient impossible de la croire. Pourtant, sa façon de réciter son discours orgasmique confère une dimension performative à l’oralité de la pornographie dissociée de sa corporalité. S’il ne fait aucun doute que l’analyse des dialogues du cinéma pornographique reste parmi l’un des moyens les plus efficaces de mettre en lumière les dynamiques culturelles et politiques de tels films, elle s’avère également très révélatrice quant à la légitimation de la profession pornographique :
The question of how best to use speech is an explicit ethical question that can emerge only later. It presupposes a prior set of questions: who are “we” such that without language we cannot be, and what does it mean “to be” within language? How is it that injurious language strikes at this very condition of possibility, of linguistic persistence and survival? If the subject who speaks is also constituted by the language that he or she speaks, then language is the condition of possibility for the speaking subject, and not merely its instrument of expression. This means that the subject has its own “existence” implicated in a language that precedes and exceeds the subject, a language whose historicity includes a past and future that exceeds that of the subject who speaks. And yet, this “excess” is what makes possible the existence of the subject. Foucault refers to this loss of control over language when he writes, “discourse is not life; its time is not yours40”.
Le rôle performatif de l’acteur dans cette scène est, quant à lui, explicitement illocutoire. Après un coït dont l’expression verbale est limitée à des grognements de nature presqu’animale, Rick Ledyk se contente de dire : « Ah, je vais venir » et vient dans l’immédiat. Malgré le fait que ces tendances locutoires soient propres au genre pornographique en général, elles semblent exacerbées par le rapport d’insécurité entretenu entre les acteurs et actrices locaux et la vulgarité de leur langue. Souvent, lorsqu’il y a dérogation à cette règle, elle est accordée aux hommes, à qui il est plus facile de pardonner un : « Hostie, bébé ! Je sais que t’aimes ça te faire fourrer, hein ? » bien senti.
Dans Les pipeuses de l’entrepôt, l’analogie entre l’oralité inhérente à la consommation de nourriture et celle de la sexualité est centrale dans la trame narrative. Elle sert également de stratégie pour transformer la banalité du quotidien en un univers pornotopique centré sur l’alimentation. Dans la première partie du film, plusieurs expressions ressortent : « Chéri, laisse-moi te manger. / Oh, t’as faim ! », « Fais aller ta langue. Mange ma chatte, d’accord ? » La deuxième partie du film s’ouvre sur l’un des acteurs qui mentionne sa recette de « ouananiche », un terme typiquement québécois qui désigne le saumon d’eau douce. Dans cette moitié du film, et notamment dans la scène du souper spaghetti, les références à la nourriture abondent sans gêne : « T’as sûrement une super de belle queue. Une queue à déguster », « Tu manges bien », « Quel délice ! » Juste avant de passer à table, les convives se mettent déjà à parler de consommer le dessert. Les spaghettis se font donc attendre pendant que les hommes font des cunnilingus aux femmes. Ils finissent par manger leurs spaghettis et c’est sur cette scène que le film se termine.
Cet imaginaire nous ramène facilement aux traditions historiques des Québécois de socialiser en famille et entre amis, autour d’une table, devant un bon souper. Il rappelle les veillées d’antan, où ça sent bon dans les vieilles maisons. Le souper spaghetti est une icône de la tablée québécoise, à la fois manière de recueillir des fonds et recette maternelle incontestée de tout un chacun. Le film nous rappelle avec une lucidité déconcertante à quel point la cuisine demeure proche de la chambre à coucher et que ces lieux débordent l’un sur l’autre, entre autres dans les chansons grivoises québécoises, qui font actuellement l’objet de recherches complémentaires de notre part. Malgré tout, la représentation des banalités quotidiennes de la vie au Québec demeure la manière la plus flagrante avec laquelle l’identité québécoise se manifeste dans ses longs métrages pornographiques, et ce, bien au-delà du langage. De ce fait, l’étude de la pornographie au Québec a beaucoup à apporter à l’analyse filmique traductologique en général.
Après avoir analysé les premiers films pornographiques produits et doublés au Québec, on constate que les particularités régionales de notre français sont rarement employées dans un contexte érotisant et qu’elles sont largement évitées. Elles n’apparaissent que dans le récit, à travers le jeu des acteurs et actrices, et lors des mises en contexte. Qui plus est, ce qui demeure le plus éloquent d’un point de vue culturel dans les films pornographiques, peu importe leur langue originale ou de doublage, c’est l’ancrage profond qu’ils présentent dans un univers culturel marqué par sa géographie et son histoire. L’analyse de ces films doublés et en versions originales confirme que la pornographie au Québec a toujours été de l’ordre du mauvais genre et n’est pas près de s’en dissocier. Bien qu’elle ait, dans sa tradition de doublage, cherché à répondre à une clientèle internationale et à égaler un marché d’exportation, elle demeure un reflet du cinéma québécois et ne manque pas de s’adresser à un public sensible à ses tabous et subtilités.
Mis à part la représentation graphique d’actes sexuels, le plus grand tabou lié à la pornographie québécoise est sans aucun doute celui de la vulgarité de la langue. Aussi la pornographie s’avère-t-elle révélatrice de l’identité profonde du texte littéraire et cinématographique québécois. Cela dit, lorsqu’on revendique que la fonction première de la pornographie est d’exciter, un doute demeure. Dans le cas du Québec, le genre pornographique est particulièrement cibliste : il doit rejoindre son public avant de pouvoir l’émoustiller. La seule façon pour les nouvelles productions de se distinguer des productions qui les précèdent est de s’adresser directement au public québécois. C’est exactement ce que font les compagnies de production AD4X et Pégas avec leurs films basés sur un régionalisme profond et un sensationnalisme tiré de l’actualité locale. Il est malheureusement difficile pour les personnes qui n’ont pas d’histoire avec le Québec de pouvoir apprécier pleinement sa pornographie.
La culture québécoise en est une où la polémique sert de porte d’entrée à l’humour et vice-versa. La pornographie, en bon marché de niche, s’accroche à ces ancrages culturels pour s’élever à un statut social qui lui permet de faire parler d’elle et de vendre. L’humour gras, les blagues de « mononcle » et autres jeux de mots douteux y sont monnaie courante : pensons seulement au célèbre personnage du Docteur Noune, héros de plusieurs productions Pégas. L’humour a toujours occupé une place importante dans la culture d’ici comme il permet de désamorcer les traumas nationaux. Notre pornographie ne fait pas exception et la perception qu’on en a dans la sphère sociale non plus. Comme le résumait de manière laconique le magazine Croc : « Ce n’est pas parce qu’on en rit que c’est drôle. »
Filmographie
3 carrés rouges (AD4X, 2013)
Agente 728 XXX (AD4X, 2012)
Babes Angels (Stéphane Chouinard, 1997)
Bonhomme Carnanal : la recherche des duchesses (AD4X, 2015)
Call of the Wild (Kristen Bjorn, 1992)
Deep Throat (Gerard Damiano, 1972)
French Erection: Au Maximum (William Dufault, 1992)
Hustler 17 (De Santos, 1984)
Jésus de Montréal (Denys Arcand, 1989)
La pêche aux sirènes (Ron King, 1993)
Les danseurs nus du Québec (Daniel Ménard, 1992)
Les danseuses nues du Québec (Daniel Ménard, 1992)
Les filles de Fantasex (Marc Hendrix, 1996)
Les filles de Fantasex 2 (Marc Hendrix, 1997)
Les pipeuses de l’entrepôt (Ron King, 1994)
L’initiation de Mélanie (Marc Hendrix, 1993)
Mémoires intimes (Marc Hendrix, 1995)
Montréal est une ville ouverte (Mr. White, 1996)
Montréal interdit (Vincent Ciambrone, 1990)
Montre-moi ton carré rouge (AD4X, 2013)
Putain de chômage (Daniel Ménard, 1993)
Québec Sexy Girls 2 : la confrontation (Christian Larouche, 1995)
Scandale (George Mihalka, 1982)
Sex and the Office Girl (Ron Clark, 1972)
Sex Fan Club (Ron King, 1994)
The Search of Canadian beaver (Shawn Ricks, 1994)
The Search for Canadian Beaver 2 (Shawn Ricks, 1995)
The Young Quebecers (Claudio Castravelli, 1980)
Valérie (Denis Héroux, 1969)
Notices biographiques
Éric Falardeau est cinéaste et doctorant en communication (UQAM). Ses recherches portent sur le cinéma pornographique. Il a été commissaire de l’exposition permanente Secrets et illusions, la magie des effets spéciaux présentée à la Cinémathèque québécoise (2013–2017). Il est le codirecteur avec Simon Laperrière de Bleu nuit, histoire d’une cinéphilie nocturne (Somme toute, 2014) ainsi que l’auteur d’Une histoire des effets spéciaux au Québec (Somme toute, 2017) et de l’ouvrage Le corps souillé : gore, porno et fluides corporels (L’instant même, 2019).
Dominique Pelletier est chercheuse multidisciplinaire et enseigne la traduction à l’Université Concordia depuis 2013. Dans le domaine de la traductologie, elle s’intéresse à la traduction interespèce, au sous-titrage, à la localisation de jeux vidéo et à la traduction érotique et pornographique. Du côté de la ludomusicologie, ses travaux portent sur la corporalité et la fétichisation des consoles de jeux vidéo rétro dans les scènes de musique chiptune. Sous le nom d’artiste Rainbow Trash, elle s’est produite avec ses instruments insolites, du Nintendo Game Boy au thérémine, sur plusieurs scènes d’Europe et d’Amérique, dont celle du GAMIQ à Montréal en 2021.
Voir Linda Williams (dir.), Porn Studies (Durham et Londres : Duke University Press, 2004) ; Peter Lehman (dir.), Pornography: Film and Culture (New Brunswick [NJ] et Londres : Rutgers University Press, 2006) ; Tim Dean, Steven Ruszczycky et David Squires (dir.), Porn Archives (Durham et Londres : Duke University Press, 2014); et Florian Vörös (dir.), Cultures pornographiques. Anthologie des porn studies (Amsterdam : Éditions Amsterdam, 2015).↩
Voir Teun A. van Dijk, Ideology: A Multidisciplinary Approach (Londres : Sage Publications, 1998) ; Gideon Toury, Descriptive Translation Studies—and Beyond , Revised Edition, (Amsterdam et Philadelphie : John Benjamins, 2012 [1995]) ; et Norman Fairclough, Language and Power, Third Edition (Londres : Routledge, 2014 [1984]).↩
Voir Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma (Paris : Klincksieck, 1968) et Roger Odin, De la fiction (Bruxelles : De Boeck Université, 2000).↩
Nous tenons à remercier Yves Bédard de la Régie du Cinéma du Québec, qui nous a cordialement fourni les listes détaillées des films pornographiques distribués au Québec entre 1980 et 1995.↩
Les loops sont de courtes bandes d’environ dix minutes le plus souvent tournées en super 8 et diffusées dans les circuits parallèles ou vendues à des particuliers.↩
Les auteurs ont par exemple eu accès à une copie noir et blanc, sans générique, d’un loop dans lequel un couple performe devant une affiche de l’Expo 67. Sans prouver qu’il s’agit d’une production québécoise, la présence de cette affiche suggère néanmoins que le contraire serait surprenant, compte tenu de l’impact de cet événement dans la province. La copie provenait en outre d’une collection privée locale, ce qui va dans le sens de cette hypothèse.↩
Un premier théâtre spécialisé dans le cinéma érotique, Le Bijou, ouvre ses portes en 1968 sur la rue Papineau, à Montréal. S’ensuivent l’ouverture du Ève (boulevard Saint-Laurent), du Beaver (avenue du Parc), du Midi-Minuit (rue Saint-Denis), du Pigalle (rue Sainte-Catherine) et, surtout, sous l’égide de Roland Smith et d’André Pépin, la transformation du Cinéma Hollywood en le Pussycat. Cette salle deviendra le célèbre Cinéma l’Amour en 1981 (voir à cet égard Pierre Pageau, Les salles de cinéma au Québec : 1896–2008 [Québec : Les Éditions GID, 2009], 78–83).↩
Yves Lever, Anastasie ou la censure du cinéma au Québec (Sillery : Septentrion, 2008), 270.↩
Deep Throat (Gerard Damiano, 1972) est un cas très bien documenté qui révèle l’attitude du gouvernement face à la production pornographique. Refusé huit fois, « [a]u Québec, Deep Throat n’est apporté au Bureau de surveillance du cinéma que deux ans [après sa sortie], le 25 octobre 1974, et il est refusé le 15 novembre suivant. Dix mois auparavant, une projection non autorisée par le Bureau a été interrompue et la copie saisie par la police dans un auditorium de l’Université Sir George Williams (aujourd’hui Concordia). De retour devant le censeur, malgré trois minutes de coupures, il demeure interdit le 18 mars 1975. Cinq ans plus tard, il est classé “18 ans” le 13 février 1980, dans une version coupée de ses scènes les plus hard, non encore autorisées. La cassette vidéo intégrale est approuvée pour “’18 ans +’” le 26 juin 1990. » Pierre Hébert, Kenneth Landry et Yves Lever (dir.), Dictionnaire de la censure au Québec : littérature et cinéma (Montréal : Fides, 2006), 177.↩
Yves Lever raconte également la tentative d’ouverture d’une chaîne payante Playboy, qui fut abandonnée suite à des manifestations anti-pornographie. Voir Hébert, Landry et Lever [dir.], Dictionnaire de la censure au Québec, 177.↩
Lever, Anastasie ou la censure du cinéma au Québec, 266–267.↩
Pageau, Les salles de cinéma au Québec, 83.↩
Avant 1983, la RCQ se nommait le Bureau de Surveillance, lui-même fondé en 1967 après avoir exercé plusieurs années sous le nom de Bureau de censure des vues animées.↩
La Régie classe désormais les films selon quatre catégories, et ce, peu importe leur support : visa général, 13 ans, 16 ans et 18 ans.↩
Yves Lever, « Loi du cinéma », dans Hébert, Landry et Lever (dir.), Dictionnaire de la censure au Québec, 424. Avec la loi 109 de 1983, « il est toutefois spécifié que la Régie ne classe un film que “si elle est d’avis que le contenu du film ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment en ce qu’il n’encourage ni ne soutient la violence sexuelle”, l’ajout à la formule habituelle étant une concession aux groupements féministes qui ont abondamment manifesté durant tout le processus parlementaire menant à l’adoption de la loi » (Lever, « Loi du cinéma », 423).↩
Lever, Anastasie ou la censure du cinéma au Québec, 271.↩
Pierre Gervais, « Vidéo XXX : derrière le rideau », Québec Érotique 1.2 (octobre 1994), 10.↩
Pierre Gervais, « Nancy, pionnière du XXX au Québec », Québec Érotique 3.8 (avril 1997), 12.↩
La question de la distribution est d’autant plus complexe que les réalisateurs d’ici vendaient leurs droits à des compagnies canadiennes, américaines ou internationales. C’était entre autres le cas d’Hendrix. Voir Pierre Gervais, « Marc Hendrix : un producteur pas comme les autres », Québec Érotique 3.8 (avril 1997) : 13.↩
La recension détaillée de la genèse et des transformations des lois entourant l’obligation de rendre disponible les films en langue française dépasse les limites de cet article. Nous dirigeons les lecteurs désirant approfondir la question vers le site Doublage Québec, www.doublage.qc.ca (dernière consultation le 13 juillet 2020) ainsi que vers les textes suivants : Anne-Marie Gill et Mélina Longpré, L’industrie du doublage au Québec. État des lieux (1998 — 2006) (Montréal : Sodec, 2008) ; Michèle Lagueux et Danielle Charron, Le doublage (Québec : Ministère des communications, 1985) ; Le développement de l’industrie du doublage au Québec. Rapport et recommandations (Québec : Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, Forum sur le développement du doublage, 2010) ; Maud Saint-Germain, Doublage-traduction ou doublage-trahison ? : les enjeux identitaires et socio-économiques du doublage des films et de l’audio-visuel au Québec, mémoire de maîtrise (Université du Québec à Montréal, 1998).↩
Voir Louis Pelletier, « Cinémas britanniques, films américains et versions françaises : doublage et identités canadiennes-françaises au vingtième siècle », Nouvelles Vues 15 (hiver 2013).↩
Germain Lacasse, Hubert Sabino et Gwenn Scheppler, « Le doublage cinématographique et vidéoludique au Québec : théorie et histoire » Décadrages 23–24 (2013) : 36.↩
Louise von Flotow, « When Hollywood Speaks ‘International French’ : The Sociopolitics of Dubbing for Francophone Québec », Quebec Studies 50 (2009) : 28.↩
Voir Feona Attwood (dir.), porn.com. Making Sense of Online Pornography (New York : Peter Lang Publishing, 2010) ; Vörös (dir.), Cultures pornographiques ; et Jeffrey Escoffier, Sex, Society, and the Making of Pornography. The Pornographic Object of Knowledge (New Brunswick [NJ] et Londres : Rutgers University Press, 2021).↩
Dominique Pelletier et Éric Falardeau, « Vers une terminologie de la pornographie », Circuit : le magazine d’information des langagiers 137 (hiver 2018).↩
Pelletier et Falardeau, « Vers une terminologie de la pornographie ».↩
Pelletier et Falardeau, « Vers une terminologie de la pornographie ».↩
Éric Falardeau et Simon Laperrière (dir.), Bleu Nuit : histoire d’une cinéphilie nocturne (Montréal : Somme toute, 2014), 36.↩
Voir Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola (Paris : Seuil, 1971) et Marie-Anne Paveau, Le discours pornographique (Paris : La Musardine, 2014).↩
Voir Éric Falardeau et Dominique Pelletier, « Le cinéma pornographique au Québec : mettre à nu le rapport entre original et traduction », Circuit : le magazine d’information des langagiers 137 (hiver 2018).↩
François Perea, « Éléments du pathos pornographique », Questions de communication 26 (2014) : 81–82, http://questionsdecommunication.revues.org/9245 (dernière consultation le 13 juillet 2020).↩
Pelletier et Falardeau, « Vers une terminologie de la pornographie ».↩
Le dépaysement dans la pornographie oscille entre deux pôles, l’un fétichisant et l’autre déstabilisant, le premier contribuant à la fonction masturbatoire du genre et le second devenant un inhibiteur à son appréciation.↩
Notons également la vague des « mondo » locaux, soit des pseudo-documentaires d’exploitation misant sur des sujets racoleurs, choquants ou inusités. Montréal interdit (Vincent Ciambrone, 1990) est un film emblématique de ce sous-genre à la québécoise. Daniel Ménard, le réalisateur de Putain de chômage, a d’ailleurs réalisé le diptyque Les danseuses nues du Québec (1992) et Les danseurs nus du Québec (1992). Ce dernier, bien connu, se termine avec une audition filmée de l’actrice Dundy Danger, future vedette de Putain de chômage, et l’annonce de la sortie de ce film, notre premier porno québécois : « un film pour adulte, avec des Québécois pour les Québécois ».↩
Écrit de cette façon dans le film.↩
Nikola Stepic, « French Connections: Gay Male Pornography as Virtual Tourism », communication présentée au colloque annuel de l’Association canadienne d’études cinématographiques (Vancouver, juin 2019).↩
Stepic, « French Connections: Gay Male Pornography as Virtual Tourism ». Stepic s’appuie sur : Stijn Rejinders, Places of the Imagination: Media, Tourism, Culture (Londres et New York : Routledge, 2011).↩
La Crise d’Oka a opposé pendant 78 jours, soit du 11 juillet au 26 septembre 1990, des manifestants mohawks à la Sureté du Québec (SQ), la Gendarmerie Royale du Canada et l’armée canadienne sur le territoire de Kanesatake. Son enjeu central, résultat de nombreuses années de conflits, était un projet d’extension d’un terrain de golf et de construction de maisons sur des terres sur lesquelles se trouvent, entre autres, un cimetière ancestral. Après le décès du caporal Marcel Lemay, un policier de la SQ, et de Joe Armstrong, un Mohawk, l’armée a été déployée et les manifestations ont pris fin. L’agrandissement du terrain a été annulé et les terrains acquis par le gouvernement fédéral (mais ils ne seront pas cédés aux Mohawks). L’un des événements médiatiques marquants de cette crise est le cliché de la photographe Shaney Komulainen qui a immortalisé le face à face stoïque entre le caporal Cloutier et Brad Larocque, un Ojibwé que les journalistes ont identifié à tort comme étant Ronald « Lasagne » Cross. Cette image est rapidement devenue le symbole de ce triste moment de notre histoire et est inscrite dans l’imaginaire collectif national.↩
Les pipeuses de l’entrepôt (Ron King, 1994).↩
Judith Butler, Excitable Speech, A Politics of the Performative (New York : Routledge, 1997), 28.↩
