Chun-Yi Kuo
En supprimant la conjonction, je crée l’effet d’un escarpement abrupt qui évoque en même temps le paysage saguenéen, encaissé dans ses falaises. J’essaie de casser l’éloquence par des ruptures de rythme ou des suppressions d’articulations grammaticales, mais toujours en préservant une lisibilité syntaxique fondée sur des groupes de mots, sur des schémas métriques. Je maintiens les rapports syntaxiques dans la phrase, dans les vers ou le vers.
Gaston Miron, L’avenir dégagé1
La plupart des études portant sur le cinéma au Québec sont faites par des chercheurs des Amériques et de l’Europe. En 2014, alors que je me trouvais à Montréal dans le cadre d’un échange étudiant et que Miron : un homme revenu d’en dehors du monde (désormais Miron) de Simon Beaulieu était lancé aux Rendez-vous Québec Cinéma, je me suis questionné sur les similitudes sociales, politiques et culturelles entre Taïwan et le Québec. En regardant Miron, avec mon œil curieux de Taïwanais, j’ai découvert une riche histoire avec laquelle je n’étais pas familier. Le Québec, son histoire, ses réalisateurs et leurs films demeurent méconnus à Taïwan. J’ignorais ainsi complètement l’existence du poète Gaston Miron qui prenait désormais vie par les images et les sons que Beaulieu a empruntés à l’Office national du film du Canada (ONF) pour réaliser son œuvre cinématographique. À l’époque, je me sentais exactement comme l’un des types de jeunes Québécois, sans véritable conscience historique, dont la récente recherche sociologique sur l’identité collective de Létourneau avait fait le portrait2. Cet essai filmique – composé uniquement des archives et suivant Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005) et Godin (Simon Beaulieu, 2011) – me fit découvrir deux phénomènes : d’une part, il me fit prendre conscience de la trajectoire identitaire à la fois individuelle et collective du poète et du Québec et, d’autre part, il m’initia à l’histoire du cinéma documentaire québécois. Lors de ma première écoute, la figure poétique de Gaston Miron se révéla à moi grâce à une poétique audiovisuelle qui prenait forme dans la répétition de certains plans, la surexposition et la saturation de certaines séquences, la fréquence d’un certain son d’ambiance. Le trouble entraîné par mon ignorance m’amena alors à adopter une approche épistémologique et phénoménologique qui me permet de passer du point de vue d’un spectateur ignare au regard d’un chercheur désirant creuser davantage les significations du film pour interpréter la démarche du cinéaste.
Dans cet article, je propose de mettre en perspective la stratégie narrative du film, à savoir le rapaillage, la répétition ainsi que la variation, et son expérimentation sur les images et les sons – qui se trouve elle-même liée à un procédé de montage singulier – afin de voir comment la reconstitution des archives a contribué à former dans l’œuvre filmique une impression forte, celle d’une collectivité mouvante. Évidemment, mon interprétation ne sera pas forcément meilleure, ni très différente de certaines autres qui l’ont précédée3. L’originalité de mon approche repose plutôt sur mon expérience personnelle de Taïwanais qui découvre le Québec avec un regard neuf, peut-être même un peu naïf. Dans tous les cas, si mes observations peuvent stimuler la réflexion de ceux qui s’intéressent à Miron, elles n’auront pas été écrites en vain.
Le rapaillage
Afin de réaliser Miron : un homme revenu d’en dehors du monde, Beaulieu et son équipe de monteurs, composée de René Roberge et de Marc-André Faucher, ont d’abord prélevé un grand nombre de plans en provenance de documents privés appartenant à Gaston Miron et d’œuvres du répertoire de l’ONF. Ils ont ensuite découpé des extraits en créant une banque d’images et les ont reconstitués numériquement. Puis, en travaillant avec Karl Lemieux et Daïchi Saïto, ils ont projeté certaines séquences sur un écran vierge et installé en même temps une caméra 16 mm devant l’écran pour filmer les images projetées. En passant d’un support à l’autre, l’équipe de réalisation a obtenu ses propres copies sur pellicule et pouvait ainsi ajouter des effets spéciaux au niveau matériel, soit en grattant la pellicule, soit en la peignant ou en la brûlant. Ce qui est particulier dans Miron, c’est qu’après avoir infligé ces traitements à certaines séquences, les cinéastes ont à nouveau transféré les images enregistrées sur un support numérique. Grâce à ce procédé, ni forcément nostalgique, ni vraiment évolutif, mais rétromédial4, la limite – ou la frontière – entre l’ancien monde et le nouveau monde cinématographiques est annulée par l’usage qu’ont montré les cinéastes de la reproductibilité technique du cinéma. De ce fait, en considérant l’archive comme « le système qui régit l’apparition des énoncés comme événements singuliers5 », l’esthétique du film se manifeste par son intermédialité tout en ponctuant la temporalité et la « rémanence » des archives6.
Mais, de nos jours, à quoi cela rime-t-il d’assembler des mots de Miron et des images d’anciens films pour réaliser un nouveau film ? Ce film a‑t-il trouvé son inspiration dans le fond de l’ONF, comme La mémoire des anges (2008) de Luc Bourdon7, pour l’objectif de « reconstituer l’évolution sociale et politique de la société québécoise et de mesurer le chemin parcouru8 » ? L’acte d’assembler, ou, pour le dire comme Miron, de « rapailler », consiste à réunir des éléments épars et à en faire plus qu’une simple restauration : « ce n’est pas de restaurer le passé tel quel, c’est de le mettre en mouvement, de le ranimer en avançant, en créant du nouveau9 ». Les premières minutes du film sont révélatrices de ce point de vue. Dès que la voix hors champ intervient dans le plan montrant une chambre lumineuse, le regard du spectateur est amené à passer par la fenêtre. Or, il n’est pas aisé pour un Taïwanais de saisir le sens de l’enchaînement des plans qui suit, puisque je vois tantôt des routes enneigées, des buildings de Montréal, tantôt des couples de danse, des danseurs avec des harmonicas, des joueurs de hockey en compétition, tantôt des pêcheurs en bateau, des draveurs en forêt, des manifestants avec leurs banderoles, des policiers armés en arrière de files de cortège.
Il est à remarquer que ces extraits ont été synchronisés avec la musique et la voix de Miron, qui scande un extrait du poème « La marche à l’amour10 ». Ce montage entraîne chez moi des réactions ambivalentes : d’un côté, j’ai le sentiment d’être exclu de cet univers kaléidoscopique ; de l’autre, j’ai l’impression d’être introduit à l’intérieur d’une mémoire fragmentée par l’interpellation de la prise de vue subjective et mouvante. Est-ce par ce sentiment, suscité par le rapaillage des archives, que Beaulieu me permet d’accéder à la mémoire de Miron, comme si j’étais, l’espace d’une séquence, dans sa propre tête ? Certes, ces extraits documentaires appartiennent à une mémoire partagée par le poète et sa génération, mais il est aussi évident que ce n’est pas uniquement la mémoire de Miron qui est mise de l’avant dans le film. C’est en effet une mémoire reformulée par Beaulieu, voire une autre vision sur l’histoire du Québec et celle du cinéma québécois.

Pour le cinéaste, outre la recherche d’images de films plutôt classiques du cinéma direct, la réalisation de Miron a également été une bonne occasion de fouiller dans ce qui a été enseveli au fond des archives de l’ONF. Car, certains des plans remployés sont en effet des plans de chutes qui me ramènent au contexte de l’époque. C’est notamment le cas du plan montrant deux mineurs qui poussent leur véhicule sur la voie d’un tunnel. Ce plan apparaît pour la première fois au moment où la voix hors champ de Miron témoigne de la responsabilité de son écriture face à l’analphabétisme de ceux qui n’avaient pas les moyens de laisser une trace dans l’histoire. Après ce plan, la même voix hors champ continue à marteler des « Monologues de l’aliénation délirante11 ». Le même plan, mais légèrement surexposé, est inséré dans une séquence où le poète déclare son engagement envers une expression politique et collective. Ce plan et les autres plans de chutes de l’ONF sont, en quelque sorte, les « cadavres » des images enregistrées au cours de l’histoire du cinéma québécois. Il a fallu attendre le remploi de Beaulieu pour ressusciter, au sens propre du terme, ces porteurs de mémoire. Ne s’agit-il pas en ce sens d’une manière « de remettre [le passé] en mouvement, de le ranimer en avançant, en créant du nouveau12 » ? C’est en fonction de cette notion de rapaillage que Miron ne me semble pas un simple film d’hommage nourri d’anecdotes biographiques13, mais un rappel au spectateur d’une ère irrévocablement révolue, voire, comme Blümlinger l’a bien cerné14, une élaboration secondaire qui, à travers une stratégie de répétition, met l’accent sur le fonctionnement des archives de l’ONF. Les va-et-vient entre divers supports contribuent à créer matériellement cet effet de distanciation historique et temporelle. Le film devient ainsi un lieu de mémoire (celle de Miron et celle de Beaulieu) à expérimenter.

Répétition et variation : les couplets, les leitmotive et les refrains dans Miron
Au cours de la projection, trois substrats énonciatifs se superposent, se croisent et se dissocient. Tantôt ils proviennent d’une même source enregistrée, tantôt ils n’ont pas de connexions directes. Le premier est la musique d’ambiance, le deuxième est composé des images provenant des témoignages, le troisième est la voix du poète, qui chante, parle et scande ses poèmes.
La musique d’ambiance est en effet une mélodie d’une fréquence dynamique. Dès le début du visionnement, je sentais la présence enveloppante de cette musique évoquant un état incertain, puisqu’à chaque fois qu’elle atteint à un régime stable de fréquence forte, elle baisse aussitôt de volume jusqu’à un niveau presque inaudible, quoique tenace et persistant. Et cela se reproduit épisodiquement tout au long de la projection. C’est dans ce mouvement alternatif que la mélodie d’ambiance devient un signe révélateur, qui répond simultanément à la reprise de certaines images et à la structure du film.
En fait, cette structure paraît construite comme un rondo. En suivant le générique d’ouverture, le plan de la citation de Miron (de 01:34 à 02:09) fonctionne comme une épigraphe indiquant le concept du montage15. Puis, la séquence préliminaire (de 02:10 à 03:14), constituée d’images surexposées, est suivie par le plan d’une chambre (de 03:15 à 04:21) qui se présente comme un prologue. Il est à noter que c’est ce même plan qui reviendra vers la fin (de 68:50 à 69:50), cette fois en tant qu’épilogue, fermant ainsi la boucle narrative. Toutefois, à y regarder de près, je constate que ce prologue comporte une variation au niveau du contenu de la répétition : il est accompagné de la voix ambitieuse de Miron qui, inspiré par deux vers de Patrice de La Tour du Pin, veut avancer par sa poésie et concrétiser un « projet global » pour la future génération. L’épilogue est accompagné de l’épanchement poétique de Miron qui, après un « voyage abracadabrant », en arrive au commencement du film, comme si rien n’avançait vraiment depuis lors. Par-là s’ouvre la clôture du rondo, avec une scène où Miron danse et chante (de 70:03 à 72:20) et où la voix hors champ du poète conclut parallèlement l’aventure de sa vie. Cette scène est suivie par le dévoilement des titres des films empruntés, qui précède quant à lui le générique de fermeture du film.
Entre le prologue et l’épilogue, je distingue plusieurs parties thématiques. Pour en faciliter l’explication, j’emprunte ici quelques termes musicaux – le film étant lui-même un poème ou un rap. D’abord, on trouve quatre « couplets », que j’intitule selon l’ordre temporel : Danse du couple (C1), Motif de l’insurrection de la poésie du poète (C2)16, Poète sur les places publiques (C3)17 et Victoires-échecs (C4). Puis, inséré à titre d’« entr’acte », on trouve le « refrain » ®, qui est lui-même composé de quatre leitmotive. Ainsi, entre les deux génériques du film, la structure de la narration pourrait être transcrite comme ceci : Épigraphe, Ouverture, Prologue, R, C1, C2, C1, R, C3, C4, C1, C3, R, Épilogue, Clôture, Hommage.
Le refrain visuel est répété trois fois durant la projection du film tout en se transformant au fur et à mesure – d’où la variation dans la répétition – de la progression narrative et, à chaque fois, il présente deux, trois ou quatre leitmotive. La première fois (de 04:26 à 11:34), le refrain succède au prologue et se présente avec la voix hors champ de Miron citant le poème « La marche à l’amour ». Sa deuxième présence (de 22:50 à 28:58) est accompagnée des poèmes « L’amour et le militant », « La marche à l’amour » et « Le camarade » et est transfigurée par un effet de surexposition. Enfin, les mêmes images (de 61:36 à 68:45) réapparaissent avec le poème « Compagnon des Amériques » et, cette fois, elles sont défigurées et embrasées jusqu’au noir total.
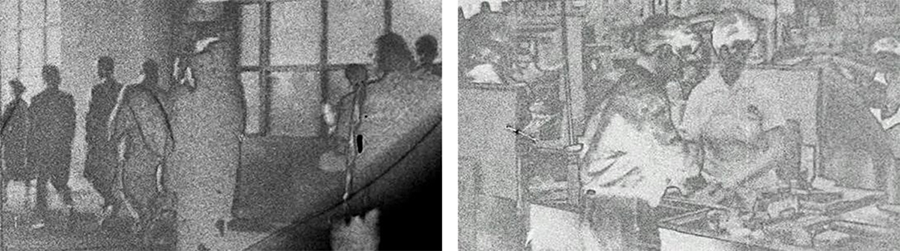

D’un point de vue thématique, les images du refrain n’ont peut-être pas une parenté évidente. Un plan qui représente un paysage quelconque du Québec peut en effet sembler sans aucun lien avec un autre plan montrant une foule dans la rue. Or j’ai déjà cité ici la réponse de Miron à Claude Filteau au sujet des suppressions de conjonction logique dans le poème « La marche à l’amour18 ». Certes, Miron prend avec elles le risque de causer des difficultés de lecture, mais son approche ne nuit pas à la lisibilité du « rapport syntaxique » dans les vers. Il en va de même dans Miron de Beaulieu. Entre les plans apparemment dissemblables du refrain, je découvre que les images des anonymes sont mouvantes. Soit ce sont les objets filmés qui sont eux-mêmes en mouvement, comme la foule qui marche vers une place ; soit c’est la caméra, tenue d’un regard subjectif, qui se meut et avance ; soit les deux mouvements opèrent : la caméra se déplace avec les objets visés, qui sont en mobilité constante. Dès lors, l’ensemble des images ne désigne-t-il pas le peuple par cette collectivité mouvante, à l’instar des expérimentations syntaxiques du poète rappelant le paysage saguenéen dans « La marche à l’amour » ? En effet, la plupart des images du film sont celles de gens ordinaires, de simples citoyens anonymes.
Il faut préciser que le refrain contient quatre leitmotive ou quatre catégories d’images, qui sont souvent peu à peu surexposés et qui ont pour thèmes, ainsi que je les nommerai, « Le paysage », « La vie quotidienne », « Le milieu des métiers » et « Les manifestations dans la rue ». Chaque leitmotiv imagé qui suit de près la citation sonore est pourvu d’une valeur documentaire. D’une séquence à l’autre, ce n’est nullement un collage surréaliste, mais un montage construit selon une certaine logique historiographique. Le couplet C2 est un bon exemple de cette logique, car quand Miron raconte sa découverte du « noir analphabète » en la personne de son grand-père, les images en noir et blanc montrent des gens absorbés par leur labeur sur un chantier. De même, quand Miron parle de problèmes politiques dans le couplet C3, la plupart des séquences insérées sont des manifestations. De telles séquences créent ainsi une ambiance cohérente et mettent l’accent sur ce dont parle le protagoniste.

Si les autres couplets sont composés d’au moins un leitmotiv, le couplet C1 n’est qu’une simple séquence où un couple, les yeux dans les yeux, danse en rond sur une musique différente de celle que l’on entend. Ce couplet, qui revient plus fréquemment que les autres19, fonctionne comme une transition entre les séquences et se présente comme un mouvement dynamique et circulaire. La danse en rond entre homme et femme suggérant beaucoup de significations imaginables, libres à chacun de l’interpréter. Il est alors possible de comparer la danse à l’amour de Miron pour le Québec libre et indépendant, une comparaison qui renvoie à la métaphore de la « femme-pays » qu’il a maintes fois figurée en sa poésie. Mais, une autre interprétation serait également possible lorsqu’on étudie les pas de cette danse – soit trois pas en avant, puis deux pas en arrière et ainsi de suite : on pourrait en effet y voir une allusion à l’aliénation du peuple, qui ne peut ni avancer ni sortir du statu quo. Ou bien, les deux interprétations sont plausibles, et cela selon la présence du couplet. Ainsi, la première signification va avec la première apparition du couplet quand un projet de l’indépendance est réalisable, alors que la deuxième l’emporte pour le dernier épisode du film, où c’est plutôt une ambiance pessimiste qui règne.
Si les premières minutes du film donnent une impression d’impénétrabilité, le couplet C2 (de 12:28 à 21:28) apporte rapidement un changement de perspective. Ce couplet de neuf minutes a une valeur biographique, puisque Miron y raconte son désir d’assumer l’existence de ses ancêtres par l’écriture. À travers la stratégie narrative, le spectateur est amené à suivre la mouvance d’images et à écouter plus tard les discours du poète « sur la place publique ». Dans le couplet C3 (de 28:59 à 45:56), le spectateur voit, entouré de la foule des manifestants, le militant Miron, qui hurle la Déclaration des droits de l’homme devant un policier en plein hiver. Ces images montrent une grande agitation, ce qui rend les plans particulièrement chaotiques. Vient ensuite l’arrestation, tandis que la voix hors champ déclame parallèlement des vers du poème « L’amour et le militant20 » et des « Monologues de l’aliénation délirante21 ».
Après le couplet C3, le spectateur peut observer une série de célébrations de victoires électorales. Puis, il entend : « On a un pays ! », un cri de Miron lancé à Gérald Godin lors de la soirée du 15 novembre 1976, qui fut un grand jour pour le Parti québécois. Miron, comme l’indiquent les vers du poème « Pour mon rapatriement », désire qu’« un jour il aura dit oui à sa naissance22 ». Cependant cet avenir rêvé ne viendra pas. C’est ainsi que dans le couplet C4 Victoires-échecs (de 45:57 à 55:44), la première partie restitue les moments des victoires électorales et la seconde représente le moment de l’échec référendaire pour la souveraineté. Vers la fin du couplet C4, le spectateur peut alors entendre l’hymne national, la musique d’ambiance ainsi que la voix hors champ qui cite le poème « La fin du passé » en exprimant la volonté d’enterrer « le corps de poésie23 ». Il faut contextualiser ici : alors que la Loi 101, le fruit d’une série de résistances pour le statut de la langue française au Québec, est affaiblie par la Cour suprême du Québec et du Canada entre 1984 et 1988, la lutte de Miron pour cette langue est à recommencer. C’est donc au couplet C4 que succèdent le couplet C1 (de 55:48 à 56:45) et encore le couplet C3 (de 56:46 à 61:35), où le protagoniste revient et explique la nécessité du combat.
J’ai comparé ci-dessus la forme structurale du film à celle d’un rondo, dans laquelle le refrain alterne avec des couplets thématiques. Cette comparaison m’a fait penser à la trajectoire d’une identité à la fois individuelle et collective. Toutefois, en dehors du refrain et des couplets récurrents que l’on retrouve dans le film, un autre plan demande à ce qu’on s’y attarde. Il s’agit du plan d’une chambre (de 03:15 à 04:21), qui précède le premier refrain et succède au dernier retour du refrain. Par sa reprise, ce plan marque nettement un départ et une fin, mais une fin en guise de retour au commencement. Si Beaulieu construit un commencement au bout de la progression narrative, rien n’est dû au hasard. Car il s’agit de l’un des grands thèmes de L’homme rapaillé. En effet, Miron a déjà opté pour une forme circulaire lors de la première édition du recueil en 1970, une édition dans laquelle le poème « L’homme rapaillé » a été mis en page liminaire, bien qu’il soit le dernier poème écrit par Miron dans le recueil24. À la lumière de ce constat, on comprend mieux la fin du film. Après le dernier refrain, le spectateur retrouve le premier plan du début du rondo et entend réciter ce poème dédié à Emmanuelle :
J’ai fait plus loin que moi un voyage
abracadabrant
il y a longtemps que je ne m’étais pas revu
me voici en moi comme un homme dans
une maison
qui s’est faite en son absence
je te salue, silenceje ne suis pas revenu pour revenir
je suis arrivé à ce qui commence
Mais, ce n’est pas tout. Il faut souligner que la stratégie de reprise est déjà annoncée par le titre annexe du film, un homme revenu d’en dehors du monde, dans lequel le verbe « reviendra » à l’origine dans le poème « Pour mon rapatriement » est remplacé par le « revenu ». La modification du titre semble suggérer que le poète est cinématographiquement « revenu » de l’autre « monde », un monde appartenant peut-être déjà au passé lointain ou définitif.
Après avoir examiné la structure formelle du film, il est difficile de ne pas remarquer certains plans tout en noir, insérés ici et là, si bref qu’ils soient. Ils surviennent dès le début et réapparaissent de façon récurrente, comme des moments de transitions grammaticales dans une expression cinématographique, ou comme autant de pauses de silence dans un morceau de musique, voire comme les trous d’une mémoire restituée qui restent à combler. Il est à souligner que ces présences du noir ne se limitent pas à l’usage d’un plan tout noir au milieu des plans, mais qu’elles peuvent être caractérisées par une image sombre ou contrastée, par des figures prises en contre-jour, par une scène progressivement noircie ou encore par une séquence partiellement surexposée.
L’expérimentation sur les images
Dans la structure du film, j’ai remarqué une séquence (de 02:10 à 03:14) qui suit le plan épigraphique et dans laquelle un plan tout en noir survient sitôt après celui-ci, sans voix ni images. Durant ces brèves quatre secondes, je ne vois rien, ni n’entends rien au niveau « sensoriel », si bien que je me retrouve dans un espace transitoire qui ne révèle pas la suite des choses. À partir de 02:15, j’entends soudainement un son qui commence à s’intensifier, et pourtant, je suis toujours dans le noir jusqu’au moment où, vers 02:22, je vois quelques images surexposées qui surgissent brusquement, sans toutefois pouvoir distinguer ce qu’elles représentent. À ce moment, il me semble que la musique et les images n’ont aucun lien direct. Il est ainsi difficile de saisir la signification – s’il y en a une – du noir. Dès la première seconde de la séquence sombre, le noir pénètre progressivement dans ma vision et, un peu plus tard, quelques images floues surgissent et attirent mon attention. Par la suite, le plan tout en noir et les images noirâtres alternent jusqu’au bout de cette séquence montée, ce qui me pousse à vouloir en interpréter le sens.
Que représentent ces images floues ? Le spectateur pourrait y reconnaître, de manière approximative, des hommes devant un comptoir équipé. Mais toutes ces images sont imprécises et mal exposées. Rien n’est certain, sinon l’impression que donne la séquence d’une existence ténébreuse avançant vers une absence silencieuse25. Je me demande s’il s’agit là d’une synthèse symbolique résumant la mémoire collective du passé, incertaine, fragile et effaçable. Mais le mouvement des images ne tarde pas à m’amener au plan d’une chambre avec une fenêtre ouverte26. C’est là que le temps s’arrête pendant quelques instants, comme si, après un voyage nocturne tumultueux, j’étais enfin arrivé à un relais. Il est à noter que, contrairement au contenu des images précédentes, les objets à l’intérieur de la chambre sont identifiables. En résumé, par l’effet singulier des images retravaillées, mélodisées et entraînées par le mouvement de la caméra, cette séquence peut être comparée à la gamme par laquelle s’ouvre le prélude du rondo, qui a pour objectif de vérifier l’accord d’un instrument musical et de se préparer à jouer ; ou encore dans un autre sens, cette séquence intégrée au début du film fonctionne comme la partie d’introduction d’une œuvre et sert à en préfigurer les thèmes principaux : le noir, le son et les images retravaillées. De plus, cette séquence me semble référer à la notion d’évolution, selon une interprétation similaire à celle du travelling, qui évoque en général une progression, ou du moins un avancement, bien qu’il s’agisse ici d’une intercalation des facteurs noir et blanc dans l’enchaînement des images. Par conséquent, il est intéressant d’interroger cette supposition dans le contexte historique du Québec contemporain, car le film me paraît suggérer une évolution sociale ayant traversé une longue période obscure au fil du temps. Le passage est blanchi, noirci ou même grisaillé par des facteurs tantôt contradictoires, tantôt ambigus, tout en changeant son apparence. Du point de vue de l’histoire du Québec, c’est comme si ces nuances correspondaient aux courants idéologiques qui s’y sont succédés, tels que les nationalismes, le laïcisme, le libéralisme, le coopératisme, l’américanisme, l’indépendantisme, le fédéralisme, etc. Ces facteurs interviennent l’un dans l’autre, l’un avec l’autre, voire l’un contre l’autre. Cependant, l’évolution continue et la société avance avec le temps.
Beaulieu paraît avoir déjà tout dit de sa propre vision de l’histoire du Québec par le réemploi d’archives en un travelling ténébreux d’images enchaînées, lequel n’arrête jamais, ni ne tarde à amener le spectateur vers la chambre lumineuse. Il emploie également une forme répétitive, ce qui fait que l’on se trouve presque toujours devant les mêmes scènes. Or par l’expérimentation, notamment l’effet d’embrasement appliqué à certaines images, ne désigne-t-il pas à la fois la violence de l’oubli et la nécessité de prendre conscience de l’état actuel du Québec dans son rapport au passé ? Évidemment, ce ne sont pas les vraies pellicules conservées à l’ONF que les artistes ont brûlées pour l’effet original, ce sont plutôt des copies qui ont été enflammées. Mais, d’une manière symbolique, et surtout spectaculaire, les images représentées me semblent souligner en même temps la performance des artistes québécois, ceux qui créent une œuvre d’art tout en détruisant leurs sources. Il est aussi vrai qu’à propos du poids de l’histoire nationale, le geste d’effacer les images du passé et de faire voir la fin des porteurs de mémoire implique, comme Jacques Derrida l’explique dans Mal d’archive (1995), une pulsion destructrice envers les archives de l’ONF, ou comme Christian Saint-Germain le critique radicalement dans Le mal du Québec (2016), une tendance inconsciente à disparaître par ignorance, sinon une certaine fatigue culturelle dont témoigne l’attitude de certains Québécois de nos jours, qui se désintéressent ou préfèrent oublier le lourd fardeau du passé27. Pourtant, techniquement parlant, les effets « entropiques » rapportés au film Miron doivent être conçus comme une avancée du temps28.
Le film ne s’arrête donc pas là. La narration reconduit mon regard de spectateur vers le point de départ de ce voyage collectif filmique – une chambre calme. Au fond de la chambre, une fenêtre donne sur une cour avec des arbres. Là, renaîtra une répétition ou commencera peut-être une autre aventure, celle de la génération future. Mais le retour du commencement signifie-t-il que la nouvelle génération devrait reprendre les projets inachevés des générations précédentes ? Pour répondre à cette question, sans doute, il faudra au moins connaître le chemin parcouru. Aussi la dernière image du film, de 70:04 à 72:20, n’est-elle pas celle de l’embrasement des images, ni des plans répétitifs. C’est en fait un Miron joyeux, contrairement aux séquences précédentes qui le montraient sérieux, un Miron qui danse, chante et invite ses amis hors champ – ou ses auditeurs devant l’écran – à reprendre le refrain de la chanson, alors qu’il continue lui-même à chanter et à danser. En même temps, la voix off du poète se demande : « hommes souvenez-vous de nous au cours de ce temps / hommes souvenez-vous de vous en d’autre temps ».
En tant que Québécois de la nouvelle génération, Beaulieu a ressaisi le fil conducteur de la poésie de Miron et achevé son essai personnel par le moyen cinématographique. En clôture du film, alors qu’il cite la parole de Miron que je viens d’évoquer, le réalisateur invite ainsi les spectateurs – eux aussi porteurs de mémoire collective – à méditer sur le passé, le présent et l’avenir du Québec à partir de ce « seul film nombreux » ou de ce « nouveau film archaïque ». Le film finit donc par un plan de focalisation subjective qui invite le regard du spectateur à franchir le seuil de la porte-fenêtre pour aller en dehors du monde, dans celui de Miron et celui de notre temps. Ces dernières minutes du film pourraient éveiller une curiosité envers l’histoire de la société québécoise, sinon, si j’ose dire, une culpabilité due à l’ignorance. Car, si Miron se veut une « impression » – serait-ce précisément l’effet d’un poème audiovisuel qu’il voudrait atteindre ? –, il s’agit d’une impression qui marque, qui persiste et qui, par son impénétrabilité même, se veut inoubliable. Bref, une impression qui nous suggère, au lieu de les raconter, l’histoire d’un peuple en survivance et en révolte et son imaginaire collectif inabouti. Est-ce dans cette impression, qui me dérange tout en me laissant un sentiment de perplexité, que réside, paradoxalement, la force lucide du film ? C’est du moins peut-être là que réside aussi l’originalité de l’essai cinématographique de Beaulieu sur la figure de Gaston Miron et sur l’histoire du Québec.
:::
Notice biographique
Chun-Yi KUO est doctorant taïwanais en études cinématographiques à l’Université de Montréal. Son projet de thèse s’intéresse à la pratique du remploi d’archives au cinéma et compare différentes expressions cinématographiques dans des axes culturellement distincts, notamment Québec et Taiwan.
Gaston Miron, L’avenir dégagé. Entretiens 1959–1993 (Montréal : Éditions de l’Hexagone, 2010), 223.↩
Jocelyn Létourneau, Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse (Montréal : Éditions Fides, 2014), 226.↩
Voir par exemple : David Nadeau-Bernatchez, « Une voix sur pellicule », Liberté no 306 (2015), 63, ou la critique de Gilles Marsolais sur le site 24 images : https://revue24images.com/les-critiques/miron-un-homme-revenu-den-dehors-du-monde/ (dernière consultation le 21 septembre 2021).↩
Dans Miron, le procédé de montage est une démarche qui part d’une remédiation (de la pellicule au numérique), qui passe ensuite par une rétromédiation pour les effets spéciaux (du numérique à la pellicule) et qui en arrive finalement à une deuxième remédiation (de la pellicule au numérique). Sur la notion de « rétromédiation », voir par exemple : Servanne Monjour, Mythologies post-photographiques. L’invention littéraire de l’image numérique (Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018), et en particulier le chapitre 7, « De la remédiation à la rétromédiation », 55–62.↩
Michel Foucault, L’archéologie du savoir (Paris : Gallimard, 1969), 177.↩
Il serait également important de noter que, pour Foucault, « [dire] que les énoncés sont rémanents, ce n’est pas dire qu’ils restent dans le champ de la mémoire ou qu’on peut retrouver ce qu’ils voulaient dire ; mais cela veut dire qu’ils sont conservés grâce à un certain nombre de supports et de techniques matériels […] selon certains types d’institutions […] et avec certaines modalités statuaires. » Ainsi, « l’oubli et la destruction ne sont en quelque sorte que le degré zéro de cette rémanence. Et sur le fond qu’elle constitue, les jeux de la mémoire et du souvenir peuvent se déployer. » (Foucault, 1969),170.↩
Voir l’entretien avec le cinéaste sur le site de Hors champ : https://horschamp.qc.ca/article/entretien-avec-luc-bourdon (dernière consultation le 21 septembre 2021).↩
Gaston Miron, Un long chemin. Proses 1953–1996 (Montréal : Éditions de l’Hexagone, 2004), 20.↩
Voir Pierre Nepveu, « Désir d’être, propos recueillis par Jonathan Livernois et Delphine Rumeau », Europe no 1031(mars 2015) : 148.↩
Voir Gaston Miron, L’homme rapaillé (Montréal : Éditions Typo, 1998) : 59–62.↩
Il s’agit des vers : « ravageur je fouille ma mémoire et mes chairs / jusqu’en les maladies de la tourbe et de l’être / pour trouver la trace de mes signes arrachés emportés / pour reconnaître mon cri dans l’opacité du réel » (Miron, L’homme rapaillé), 93.↩
Voir Nepveu, « Désir d’être », 148.↩
Il est important de souligner ici la différence qui distingue la pratique du remploi d’archives dans Miron de Simon Beaulieu et dans Gaston Miron (Les outils du poète), documentaire réalisé par André Gladu en 1994.↩
Voir Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main. Esthétiques du remploi dans l’art du film et des nouveaux médias (Paris : Klincksieck, 2013), 17–84.↩
Il s’agit de la citation du poème « En une seule phrase nombreuse » de Gaston Miron, dans lequel le poète écrit : « Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés / – poètes de tous pays, de toutes époques – / je n’avais pas d’autres mots, d’autres écritures / que les vôtres, mais d’une façon, frères, / c’est un bien grand hommage à vous / car aujourd’hui, ici, d’un homme à l’autre / il y a des mots entre eux, qui sont / leur propre fil conducteur de l’homme / merci. » Il est évident que ce poème avant toute image a pour objectif de rendre hommage à la fois au poète et aux cinéastes qui ont précédé Beaulieu, précisément ceux qu’il a « pillés ». Il est à noter que je me réfère ici, comme le cinéaste l’a montré dans Miron, au poème de l’édition de L’homme rapaillé de 1970, qui est légèrement différent de celui de l’édition de Typo de 1998. Pour plus de détails, voir Miron, L’homme rapaillé, 88.↩
L’expression « insurrection de la poésie » vient en effet d’un vers de Gaston Miron, qui l’écrit dans le poème « Demain, l’Histoire » du cycle « Six courtepointes » (Miron, L’homme rapaillé, 173)↩
L’expression « sur les places publiques » vient en effet du poème « Sur la place publique, recours didactique » du cycle « La vie agonique » de Gaston Miron, qui assume son rôle public de poète en luttant contre des injustices sociales (Miron, L’homme rapaillé, 99–100).↩
Pour plus de détails, voir l’entretien complet Miron,L’avenir dégagé, 213–228.↩
Au total, le couplet C1 apparaît trois fois dans Miron, d’abord de 11:37 à 12:25, puis de 21:29 à 22:47 et, enfin, de 55:48 à 56:45.↩
Voir Miron, L’homme rapaillé, 109.↩
Voir Miron, L’homme rapaillé, 93–94.↩
Voir Miron, L’homme rapaillé, 87.↩
Voir Gaston Miron, Poèmes épars (Montréal : Éditions de l’Hexagone, 2003), 23.↩
Dans la première édition des Mots à l’écoute (1979), Pierre Nepveu a déjà expliqué cette complexité du « commencement » dans la poésie de Miron : « [O]n pourrait demander à bon droit pourquoi “L’homme rapaillé” n’apparaît pas à la fin du recueil, comme une sorte d’épilogue au long voyage de la parole. C’est que […] ce poème se situe aussi au début du voyage, à l’origine de la parole que fera entendre le recueil. Il n’y a pas de commencement absolu ni de “rapaillage” définitif. Le silence où l’homme retrouve son unité est en même temps le point de départ de l’aventure. » (124–125) Ensuite il précise que « [par] là, Miron exprime superbement la circularité que toute écriture et toute vie ne cessent de parcourir : pour écrire, pour vivre, il faut déjà être “rapaillé”, avoir touché cette coïncidence silencieuse avec soi-même » (125).↩
D’après ma recherche, cet extrait que Beaulieu a remployé est une séquence provenant de Manger (1961) de Gilles Carle et Louis Portugais, qui a été filmée à l’intérieur du restaurant Dunn’s au centre-ville de Montréal. Pour plus de détails, voir le site de l’ONF : https://www.onf.ca/film/manger/ (consulté le 21 septembre 2021), et en particulier le passage de 17:19 à 18:17 dans Manger.↩
Ce plan d’une chambre lumineuse, repris deux fois par Beaulieu dans Miron, provient en effet du premier plan (de 00:53 à 01:59) de Saint-Denys Garneau (1960) de Louis Portugais. Pour plus de détails, voir le site de l’ONF : https://www.onf.ca/film/saint-denys_garneau/ (consulté le 21 septembre 2021).↩
Il importe de noter, à la suite d’Hubert Aquin, que « [le] Canada français est en état de fatigue culturelle et, parce qu’il est invariablement fatigué, il devient fatigant. C’est un cercle vicieux. Il serait, sans aucun doute, beaucoup plus reposant [pour lui] de cesser d’exister en tant que culture spécifique. » Voir Hubert Aquin, « La fatigue culturelle du Canada français », Liberté 4.23 (mai 1962) : 315.↩
Ainsi que l’affirme Christa Blümlinger, « [dans] la mesure où le cinéma non seulement enregistre, mais rend aussi perceptible le déroulement d’un mouvement, il incarne en tant que médium le caractère irrémédiablement éphémère de processus inscrits dans le temps ». À ce sujet, voir Blümlinger, Cinéma de seconde main, et en particulier la section « Esthétique de la décomposition » du chapitre 1, 49–55.↩
